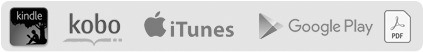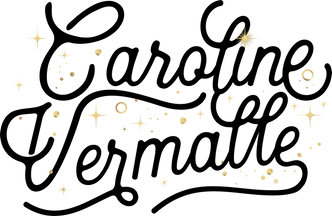— Merci de m’avoir écouté, Pétronille. Vous savez, quand on est à la fin de sa vie, comme moi, tant de souvenirs ressortent et on ne sait pas quoi en faire, parce qu’il n’y a personne à qui les dire. Alors ils restent, ils prennent la place du présent et là on est foutu.
19 décembre

Pétronille rassembla ses esprits, ses choux et son sac à main et bafouilla qu’Ernest devait être fatigué et qu’il était temps pour elle de rentrer. Ce qui était ballot, vu l’effet que lui avait fait Jamel.
— Merci de m’avoir écouté, Pétronille. Vous savez, quand on est à la fin de sa vie, comme moi, tant de souvenirs ressortent et on ne sait pas quoi en faire, parce qu’il n’y a personne à qui les dire. Alors ils restent, ils prennent la place du présent et là on est foutu.
Elle se leva et lui dit, en marchant vers la porte :
— Je reviendrai, Ernest. Gardez-les au chaud vos souvenirs, vous me les raconterez... après Noël.
Elle se retourna.
— C’est vrai, ça, je devrais vous souhaiter Joyeux Noël, c’est dans deux jours...
Elle revint sur ses pas et embrassa le vieil homme.
— Joyeux Noël, Ernest.
Il leva les yeux sur elle.
— Joyeux Noël à vous... Savez-vous, ma chère Pétronille, que toute cette conversation m’a donné faim ? Un dernier pour la route ?
Pétronille reposa son sac et ouvrit la boîte de choux. C’était une façon tellement élégante de lui demander de rester. Avait-il vu les étincelles entre elle et Jamel ? Allait-il jouer les cupidons ?
— Allez, juste parce que c’est vous. Un dernier pour la route, fit Pétronille.
— Vous savez, Jamel n’est pas mon fils naturel.
Et Pétronille comprit qu’Ernest voulait qu’elle reste parce qu’il fallait qu’il dise ces choses qu’il n’avait pas encore dites. Elle réalisa aussi qu’elle mourrait d’envie de savoir qui était Jamel et comment il était entré dans la vie du vieil homme. Elle s’assit à côté du lit.
— Jamel est un garçon que j’ai rencontré dans cet hôpital, oui, ici même. C’était il y a plus de vingt ans. On nous avait mis dans la même chambre, Jamel et moi. On me traitait pour un infarctus et Jamel était un garçon perdu de dix-huit ans. Il était miné par la drogue et l’alcool, avec une jambe à moitié écrasée dans un accident de voiture. Simon venait me voir, mais Jamel, lui n’avait personne. Nous sommes devenus amis. Puis Simon et moi l’avons un peu adopté. Ou plutôt, c’est lui qui nous adoptés. On dit que la famille n’a rien à voir avec le sang, mais plutôt avec une main tendue. Et peut-être lui ai-je tendu la main, au petit Jamel, parce que... parce que je n’ai pas pu la tendre à mon vrai fils.
Pétronille s’était approchée, car la main d’Ernest tremblait. Comme elle avait voulu prendre la main de Frédéric, elle prit celle d’Ernest.
— J’ai eu un fils avec mon épouse. Frédéric. Le petit garçon le plus précieux au monde. Nous nous entendions si bien, lui et moi. Il était... ah Pétronille, comment vous le décrire... qu’importe, vous comprenez, c’était mon enfant, mon petit. Et je l’aimais plus que tout. Il avait sept ans cet hiver-là. Quand la vérité a éclaté, la famille de ma femme ne m’a pas donné le droit de le voir. Je n’ai pas pu lui dire au revoir, mais je pensais toujours que je le reverrai, quand les cœurs se seraient calmés. J’espérais toujours que ma femme me pardonnerait, qu’elle comprendrait que ce que je vivais avec Simon n’était ni dégénéré ni même... contagieux. Tous les jours, toutes les nuits, je pensais à lui, mon petit, mon garçon qui devait grandir et me ressembler – et je n’étais pas là pour le voir.
À tous ses anniversaires, j’envoyais un petit cadeau. Tous les ans, à Noël, moi aussi, comme tous les autres parents, j’étais dans le rayon jouet du grand magasin, à passer des heures à choisir l’article qui l’émerveillerait le plus, l’imaginant en train de jouer, dans son petit pyjama au pied du sapin que je n’avais pas décoré. Je choisissais le plus beau paquet cadeau, et les rubans aussi, et il y avait toujours une étiquette qui disait « pour Frédéric, de la part de ton Papa qui t’aime fort ». Et chaque année, pendant dix ans, je redoutais la venue du facteur les jours après Noël. J’espérais qu’il ne viendrait pas, mais à chaque fois il venait, me rendant mon paquet qui n’avait pas été ouvert et la petite étiquette qui n’avait pas été lue.
Si j’avais su, ce jour de décembre 79, que je ne reverrais plus jamais mon fils, aurais-je quitté Simon ? Pourtant, sachez Pétronille que cet homme m’a donné vingt ans de bonheur. Nous partagions notre vie entre sa maison à Vétheuil, proche de celle où habitait Monet et un appartement à Giverny. Simon est devenu chef jardinier à Giverny, je m’occupais de sa galerie d’art, qui a fermé il y a quelques années. J’ai même créé quelques calendriers. J’ai vécu une vie heureuse, grâce à Simon. Voyez Pétronille, le choix que le destin m’a demandé de faire. Choisir entre mon plus grand amour et mon plus grand trésor.
Souviens-toi de ce bel amour, Qui cachait l’hiver en son sein, pensa Pétronille. Mais avant qu’elle puisse se rappeler où elle avait entendu cette phrase, Ernest continua.
— J’ai perdu la trace de mon fils un peu avant ses vingt ans, mais l’ai retrouvée plusieurs années après grâce à un article de journal, qui annonçait qu’il avait été pris dans une grande université américaine. C’est Jamel qui a insisté pour que je lui écrive, je n’en aurais pas eu le courage seul. Je lui ai envoyé une longue lettre lui expliquant ma vie et lui demandant de me pardonner. Cette lettre aussi, m’a été retournée par le facteur, à l’adresse de Jamel, où Simon et moi résidions lorsque nous descendions à Paris. Je n’ai pas pu lui dire au revoir, mais tout ce temps, je ne me suis jamais résigné.
Jusqu’à... jusqu’à ce que la vie m’ordonne de faire mes adieux à tout ce qui m’est cher. Et lui, mon fils, il n’est toujours pas là pour que je lui dise au revoir. Je sais que Jamel, cher Jamel qui déborde toujours d’idées, complote derrière mon dos pour que nous nous revoyions. Je le laisse faire. Je le laisse faire, mais...
Il sourit à Pétronille et Pétronille sut alors qu’il était temps de partir.
Frédéric était étendu de tout son long, à même le sol, sur son parquet, les ongles noirs de terre et la chemise sale. Le fauteuil avait disparu, la console aussi. Des cartons de déménagement étaient plaqués contre les murs, et renfermaient un contenu désordonné, de ce qui avait jadis été rangé dans des antiquités précieuses. Et Frédéric, au milieu de tout ça, avec des dizaines de livres sur les Impressionnistes, éparpillés autour de lui.
Il était rentré de Giverny à la tombée de la nuit. Son corps avait arrêté de trembler. Il avait passé plusieurs heures à la gendarmerie de Giverny, où sa véritable identité avait été révélée en quelques minutes. Le jardin de Monet était classé au patrimoine de l’Unesco et le vandalisme était sévèrement puni. Frédéric avait évité l’incarcération immédiate, mais il allait écoper d’une amende conséquente et passer devant le tribunal. Les gendarmes l’avaient laissé rentrer chez lui dans l’après-midi. Maître Frédéric Solis avait à présent un casier judiciaire.
Quand Frédéric fit ses premiers pas dans la rue en sortant de la gendarmerie, il fut accueilli par la neige. Elle n’avait cessé de tomber, mollement, depuis le matin. Il ne savait plus trop où aller. Il n’avait pas envie de rentrer chez lui. Il sentait la sueur et le café, et il avait froid. Immobile sur le trottoir, il repensa aux « Nymphéas ». Ces nymphéas qui poussaient sous le nez de Monet, comme elles poussent dans des milliers de jardins anonymes. Quel avait été cet instant divin où l’artiste avait changé son regard et découvert le sublime dans l’ordinaire ? Une lumière différente peut-être ? La suggestion d’un ami ? Une joie dans le cœur qui le pousse à tout célébrer, ou alors une grande solitude qui s’accroche à un nénuphar ?
Sans réfléchir, alors que les flocons de neige mettaient du blanc dans ses cheveux, Frédéric prit son téléphone et appela Marcia.
Elle ne répondit pas.
À présent, il était toujours dans ses habits sales, allongé sur le parquet dans son appartement désordonné et son regard s’était posé sur le tableau de Sisley. Son estomac se serra et il détourna les yeux. Il lui manquait 30 000 euros pour le sauver de la saisie des huissiers. Une bouchée de pain, un vingtième de sa valeur, mais une somme impossible à trouver. Frédéric fixait l’ampoule nue qui pendait au plafond là où avait été suspendu encore récemment un lustre en cristal. Après-demain arrivait si lentement. Après-demain… le rendez-vous à Orsay.
Soudain, on frappa à la porte. L’angoisse passa sur le visage de Frédéric et il se releva, ses habits froissés, scrutant la porte d’entrée. Qui pouvait bien venir à cette heure de la nuit ? Il regarda sa montre : il n’était que 18 heures. Il avait perdu la notion du temps. Il ouvrit : c’était l’homme du carnet d’adresses de Witherspoon.
Michael S. était l’agent immobilier des grandes fortunes, pour lesquelles il vendait et achetait des biens de prestige. La plupart des transactions se faisaient rapidement, souvent en liquide et laissaient peu de traces. Frédéric l’avait contacté avant la débâcle Witherspoon et, n’étant plus habitué à ne pas avoir d’assistante, il avait oublié le rendez-vous.
Frédéric s’excusa du désordre, mais l’agent immobilier n’écoutait pas. Il se dirigea vers la fenêtre pour inspecter la vue. Puis passa de pièce en pièce.
— Combien de chambres ? demanda l’agent.
— Une. Plus un coin bureau.
— Avec la surface au sol que vous avez, ce bien devrait avoir au moins deux belles chambres, et une petite troisième. Vous avez fait des travaux ?
— Oui, admit Frédéric.
— Je vois. Avec une chambre en plus, je pourrais vendre votre appartement à un meilleur prix.
— Je désire le vendre en l’état, interrompit Frédéric.
L’agent immobilier savait qu’il n’était jamais la peine d’insister. Ils signèrent les papiers, l’agent remarqua « joli tableau » quand il passa devant le Sisley et s’en alla.
Frédéric marcha vers la fenêtre. Il prit son téléphone et appela Marcia. Pas de réponse. Il regarda dehors, où le cœur de Paris battait sans lui. Bientôt, cette vue ne serait plus à lui. Pourtant, bizarrement, il ne ressentit aucune tristesse. À vrai dire, il ne ressentait rien du tout. Aucune joie, aucune peine. Juste le temps qui s’égrenait quelque part et le tirait vers un monde d’imprévu. Il avait cette certitude qu’après le 24 décembre, plus rien ne serait jamais comme avant. Il allait droit dans l’œil du cyclone, et cet œil qui le regardait, c’était celui de Caïn. Il tira les rideaux et alla s’asseoir par terre, devant le chemin enneigé du tableau de Sisley. Autant en profiter une dernière fois.
À minuit, il était toujours à la même place. Sur son réveil, dans sa chambre, le 22 décembre devenait le 23. Encore un jour, et il faudrait aller au Musée d’Orsay.
Á suivre demain...