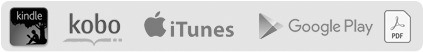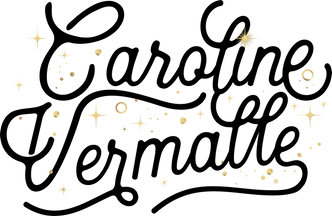18 décembre

Ne trouvant pas l’étranger sur le pont, Frédéric frissonna de tout son corps. Le froid dans ses pieds et ses mains commençait à devenir douloureux. Peut-être valait-il mieux rentrer. Cette enveloppe était la raison pour laquelle Fabrice Nile avait voulu qu’il vienne ici, il l’avait en sa possession à présent. Il pouvait partir. Soudain, un bruit au milieu du silence le fit se retourner. Le cri d’une pie ; elle avait pris son envol depuis un petit panneau au bord de l’étang.
Pourquoi Frédéric fixait-il ce bout de bois ? C’était juste un panneau d’information pour les touristes. Et pourtant, quelque chose malgré lui, un instinct, une sorte de superstition, le fit descendre du pont pour aller lire ce qui y était inscrit sur le panneau.
“J’ai mis du temps à comprendre mes nymphéas… Je les cultivais sans songer à les peindre… Un paysage ne vous imprègne pas en un jour… Et puis, tout d’un coup, j’ai eu la révélation des féeries de mon étang. J’ai pris ma palette. Depuis ce temps, je n’ai guère eu d’autre modèle.” Claude Monet.
Frédéric resta interdit. Il prit dans sa poche son ticket d’entrée et relit le poème.
Cueille à temps les féeries de ton étang
Ou règne bientôt sur un océan
De fleurs fanées
Frédéric ragea. Qu’avait-il sous son nez, qui allait se révéler être le trésor de sa vie ? Car c’est cela que l’énigme signifiait, cette fois-ci. Quelqu’un voulait lui donner une leçon avec de la philosophie de comptoir.
Puis soudain, Frédéric comprit. Il revit l’adolescent dans le train et le capitaine... Ces rencontres faisaient toutes parties du plan. Tous les détails, toutes les conversations, rien n’avait été laissé au hasard, tout était un signe. Ce n’était pas une coïncidence qu’il y avait un autre invité dans le jardin à cette heure-ci ; sa rencontre avec lui était prévue. Son cœur battait la chamade. Il fallait retrouver le flâneur, cet étranger qui rôdait dans le jardin, il fallait le retrouver coûte que coûte et le faire parler. Frédéric sentit la colère s’emparer de lui et il partit comme un fou. Il courait, courait, mais il ne parvint pas à rattraper l’étranger. Lui aussi, comme tous les autres, avait disparu. Des ombres bougeaient à travers les saules décharnés dans la lumière d’hiver, mais Frédéric ne distinguait pas la silhouette complète. Comment pouvaient-ils disparaître aussi vite, ces étrangers qui lui parlaient, étaient-ils des fantômes eux aussi ?
Il courut, Frédéric, à en perdre le souffle. Deux fois, il glissa sur la neige et se releva et courut à nouveau. Puis il s’arrêta ; il était de retour sur le petit pont japonais. Sa poitrine battait d’une rage incandescente et la sueur froide collait à ses vêtements. Il avait parcouru tout l’immense jardin. Il se mit à crier :
— Je sais que vous êtes là ! Montrez-vous !
Immédiatement, tout le jardin de Monet se tut. Et Frédéric aperçut une silhouette derrière les saules.
« Simon Offenbach insista pour me montrer tout le jardin. Il y avait tellement de recoins inaccessibles, mais il avait pris une petite faux pour couper les ronces et nous permettre d’explorer. À chaque arrêt, il faisait naître dans mon esprit avec une grande clarté, comme par magie, la toile impressionniste qui s’en était inspirée : « La Maison de l’Artiste vu du Jardin aux Roses », « Le Pont Japonais », « La Barque », « Nymphéas », « Iris Jaunes et Mauves », « L’Allée des Rosiers », « Saule Pleureur », « Le Jardin de l’artiste à Giverny ». Mais il conjurait aussi ce qu’il appelait la « vérité du jardin », c’est-à-dire les noms de toutes les plantes et le dessin des parterres, comme son créateur les avait imaginés. Combien de temps avons-nous passé dans le jardin ce jour-là ? Je ne pourrais le dire. Il me semblait que le temps s’était arrêté, et mon nouvel ami me dit que c’était un de ses gros soucis : dès qu’il commençait à jardiner, il perdait la notion du temps. C’était sans doute pour cela que la minuscule galerie d’art qu’il possédait dans la grand-rue de Giverny perdait autant d’argent. Cela le faisait rire.
Je n’arrivais toujours pas à trouver pourquoi son visage m’était si familier. Ce n’était pas seulement ses traits : après ces quelques heures passées ensemble nous étions comme des amis de longue date, parfaitement à l’aise l’un avec l’autre. Plusieurs fois, je proposai les noms de connaissances que nous aurions pu avoir en commun. À chaque fois il niait, et à chaque fois il riait.
Je repoussais dans ma tête l’heure des trains. J’en avais déjà manqué tant, mais je me disais que je prendrais le prochain. Et le prochain. Et encore celui d’après. Nous passâmes par sa petite galerie. La nuit tomba. Je n’avais pas mangé et je n’avais pas faim. Surtout, je n’avais pas envie de partir.
L’amitié de cet homme était soudain venue éclipser toutes les autres. Ce Don Quichotte parti en guerre contre le temps et ses mauvaises herbes inspirait en moi des possibilités. Si un homme ordinaire pouvait recréer le jardin d’un des plus grands artistes de l’histoire, alors moi aussi, je pouvais faire de grandes choses. Il me poussait des ailes.
Enfin, je risquais de ne plus pouvoir prendre de trains du tout. Ma montre était formelle, nous avions passé huit heures ensemble, ce qui était tout à fait inconcevable. Je dus prendre congé de lui ! Il proposa de m’accompagner à la gare. La neige se remit à tomber à gros flocons qui se pressaient dans la lumière jaune des lampadaires. La rue était déserte. Juste avant la gare, au coin d’une petite rue, Simon Offenbach s’arrêta. Il me dit que les trains qui partent le rendaient toujours profondément triste ; il préférait me quitter là. Et je vis que oui, il était bien triste. Je le rassurai en lui donnant ma carte, nous nous reverrions. Alors, il me regarda et fit un geste qui bouscula mon âme : il caressa ma joue.
Ma joue que seules quelques femmes avaient caressée, moi, un homme marié. Car j’étais marié, vous l’avais-je dit ? Comment cet homme pouvait-il oser douter de ma virilité, pouvait-il souiller notre innocente amitié avec des pensées aussi dégénérées ? Cette caresse brûlait comme la honte et je lui envoyai une gifle qui le fit trébucher. Je remerciais Dieu que la rue soit déserte et qu’il n’y ait aucun témoin de cet échange indigne. »
Ernest s’arrêta encore.
« J’aurais dû m’arrêter là, bien sûr. Partir prendre mon train, ne pas me retourner et oublier Simon Offenbach. Mais mon cœur bouillonnait encore de son insulte, la rue était déserte et ma tête... ma tête... j’avais perdu la tête. Alors, je me précipitai sur lui de toute ma rage et...
... et je l’embrassai. »
La silhouette était passée de l’autre côté du petit étang. Le vent silencieux qui faisait bouger les branches molles du saule découvrait par intermittence sa taille haute et fine, son habit sombre. Frédéric ne bougea pas et cria par-dessus l’onde froide :
— C’est vous, n’est-ce pas ? C’est vous, Fabrice Nile ? L’adolescent tatoué, le capitaine aux cuissardes, c’est vous tous ? Hein ? Répondez !
La silhouette paraissait parfaitement placide.
— Et Jamel ? Lui aussi, il fait partie du complot ? Hein, qu’est-ce que vous voulez de moi ? Me rendre fou ? Comment osez-vous j-j-jouer avec ma vie ? continua Frédéric, la salive au bord des lèvres, les joues empourprées et le souffle court.
— J’en ai assez des charades, de toutes ces phrases qui ne veulent rien dire, de cette sagesse de gare ! Qu’est-ce que vous voulez ? De l’argent ? J’en ai plus, je suis ruiné, j’ai tout perdu à cause de vous ! RÉPONDEZ-MOI !!!
Frédéric se mit à courir vers le petit pont pour rejoindre l’autre rive. La violence tambourinait dans son cœur, mais il s’arrêta net au milieu du pont. Le vent avait découvert le visage de l’homme derrière les saules.
C’était un épouvantail.
À ce moment, la neige se remit à tomber dans le matin blanc et c’était comme si le jardin montrait aux hommes un autre chapitre de sa splendeur. Mais Frédéric ne la vit pas. S’il s’était vu, pourtant, là, seul au milieu de la plus grande oeuvre de Claude Monet, dans ces paysages d’hiver qu’il aimait tant. Il aurait pu être une toile illustre ou un calendrier de décembre tant il était homme au milieu de toute cette beauté, baigné de la lumière froide d’un hiver extraordinaire, ses pas dans la neige.
Mais il ne vit rien que sa colère qui peignait des croix rouges sur le jardin blanc et il donna un coup de pied dans le pont japonais. Entraîné par sa propre audace, il se mit à arracher les iris et les rosiers, à prendre la terre grise à pleines mains, à cogner les saules et les bambous.
Il ne fallut pas longtemps à la sécurité de la Fondation Monet pour appréhender ce fou qui détruisait le jardin. Il se rendit sans broncher. Quand les gendarmes lui demandèrent son nom, il répondit sans sourire :
— Fabrice Nile.
— Ce soir-là, je rentrai chez moi et, pour la première fois, mentis à ma femme. Je revis Simon et mentis encore. Et encore. Mais l’amour qui grandissait entre Simon et moi brûlait par son optimisme tout le reste de mon existence. J’ai vécu avec lui presque deux semaines d’un amour secret et, oui, je crois, ivre. J’étais ivre d’espoir. Tout devenait neuf. Ma vie n’avait désormais de sens que dans la présence solaire de Simon. Nous nous voyions à Giverny ou dans sa maison à Vétheuil. Je ne sais plus ce que je pensais à l’époque, comment cette double vie pouvait continuer. Je crois que je ne pensais pas. Je vivais les jours comme ils venaient, je vivais plus que je n’avais vécu auparavant. Je vivais deux, trois, mille vies splendides. Je vivais pour la première fois en étant profondément moi-même et c’était une renaissance.
Notre relation contre nature n’était pas hors-la-loi, mais était très sévèrement condamnée par la société. À cette époque, la libération sexuelle des années 70 n’était pas encore arrivée dans les petites villes normandes. Je me demande même si elle y est arrivée aujourd’hui. Nous devions nous cacher. Simon n’était pas marié et, contrairement à moi, il n’avait pas autant à porter le fardeau du secret. Sa légèreté, comme sa joie, était contagieuse. Au fil des jours, nous prenions moins de précautions à cacher notre amour. Et ce qui devait arriver est arrivé, bien sûr. Le 19 décembre, ma femme nous a surpris. La tendresse qu’elle avait eue pour moi pendant nos neuf années de mariage, se mut en un instant en une haine fulgurante. Elle exigea que je quitte le domicile conjugal, immédiatement. Elle me menaçait d’une humiliation publique et dévastatrice à moins que... à moins que... je disparaisse à jamais.
C’était le 19 décembre 1979. Cinq jours avant Noël. Car ce que j’ai omis de vous dire, Pétronille... »
À ce moment-là, Pétronille qui était accrochée aux lèvres d’Ernest, entendit une voix enjouée derrière la porte et la poignée qui se tournait. Le visage d’Ernest s’illumina instantanément, et il s’écria :
— Ah, Pétronille, je vais pouvoir faire les présentations. Voici mon fils.
Pétronille se raidit, manqua un battement de cœur et tira sur son cardigan.
Et la porte s’ouvrit sur Jamel.
Jamel regarda Pétronille et Pétronille regarda Jamel et on aurait pu dire que l’affaire était faite. Mais comme Jamel ne pouvait décemment pas dire :
« Mademoiselle, je vous trouve très belle et quelque chose dans mon ventre me dit que je vous aime déjà, mais vraiment je ne saurais pas dire pourquoi parce que je ne vous connais pas, mais faisons confiance aux papillons dans l’estomac et partons ensemble refaire le monde »... il se contenta de dire :
— Bonjour.
Et elle, plutôt que de dire :
« Monsieur, vous avez tout l’air de celui que je recherche, ces yeux qui se posent sur moi tout délicatement c’est nouveau ça, s’il vous plaît ne les détournez pas, car vraiment j’aime beaucoup »... elle lui dit :
— Un chou ? et tendit son tupperware.
Jamel se reprit enfin, répondit « Non merci », regarda Ernest et lui dit :
— Je suis passé pour prendre... euh... c’est quoi déjà ce que je suis venu prendre...
— Tu devrais vraiment goûter les choux de Pétronille, ça te remettrait les idées en place.
— Pétronille... Jamel, lui fit-il en lui tendant la main.
À ce moment on frappa à la porte, et la tête de Maurice apparut dans l’encadrement.
— Ernest, comment va ? Mademoiselle, ravi de vous revoir. Euh, Jamel, tu as deux minutes ?
La tête de Gilles apparut sous celle de Maurice.
— Hey Ernie, fit l’adolescent.
— Bonjour, Gilles, ça va mon garçon ? répondit Ernest.
— À fond.
Puis la tête de Bertrand dépassa celle de Maurice. Pour tout salut, il leva son chapeau de pirate.
Jamel pouffa quand il les vit tous les trois et fit :
— Pétronille, je vous présente Gaspard, Melchior et Balthazar, ils ont suivi l’Étoile du Berger jusqu’ici...
— Dis, le berger, s’il veut pas être dans la mouise, il devrait ramener son étoile pronto, avertit Bertrand.
— Il faut qu’on cause, clarifia Maurice.
— Crisis meeting, ajouta Gilles.
— C’est bon, j’arrive. »
Avant de sortir, il fit à Pétronille :
— Je reviens. Gardez-moi un chou !
Á suivre demain...