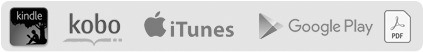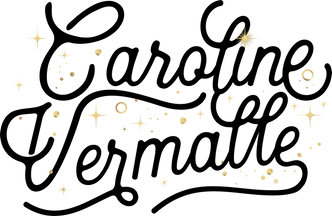2 décembre

CHAPITRE 3
— Frédéric ? Frédéric ! Frédéric !!!! »
Frédéric, sept ans, était recroquevillé sur son lit dans sa petite chambre au fond du couloir. Il fixait des yeux un bout de la tapisserie qui se décollait un peu, tout en mâchouillant sa médaille en or de la Vierge Marie. En vérité, il ne regardait rien, il écoutait. Depuis trois jours, les bruits de la maison étaient devenus étrangers. Étrangers aussi les yeux rouges de sa mère, la présence de ses grands-parents, les silences embarrassés des grands. Frédéric guettait le craquement d’une porte qui s’ouvre, la voix grave et enjouée de son père. Les syllabes chantantes d’une longue histoire qui expliquerait tout. Les bruits du retour de Papa. Mais depuis trois jours qu’il l’attendait, ces bruits ne venaient toujours pas. Et ce matin, c’était Noël. Noël 1979.
Frédéric était enfant unique, tout comme ses deux parents. Son père travaillait pour une marque de papeterie et produisait des calendriers. C’était un homme doux, cultivé, drôle. Ponctuel. Absent par la pensée, souvent – il se retranchait dans son monde à lui, particulièrement lorsque Frédéric faisait des bêtises, laissant sa femme faire la discipline –, mais il était toujours à la maison quand il devait y être. Et il aimait tant Noël. La décoration de l’arbre, surtout. Cette année-là, le sapin avait été acheté le 5 décembre – cinq jours plus tard que l’année précédente, où le jour de Noël, des milliers d’épines sèches tombaient de l’arbre décharné dès que Frédéric frôlait une branche. On avait ri et promis que l’année prochaine on serait un peu plus patient. Alors le 5 décembre, cette année-là, pendant que sa mère installait la crèche, Frédéric et son père avaient drapé l’arbre de boules rouges et vertes et de guirlandes qui, chaque année, devenaient moins fournies. Ce matin-là, Frédéric savait que l’arbre, dans la salle à manger, clignotait dans l’obscurité. L’arbre aussi attendait Papa.
— Frédéric ! Descends-tu, mon pinçon ? » La voix de sa grand-mère, qui avait toujours été douce, l’était encore plus depuis trois jours.
Frédéric glissa de son lit et traversa le couloir froid, droit dans son pyjama de flanelle aux manches trop courtes. Il arriva dans la cuisine. Sa mère avait le dos tourné et faisait du pain grillé. Elle avait beaucoup le dos tourné depuis trois jours. Il ne voyait que son chignon, impeccablement tiré, comme toujours. La grand-mère de Frédéric, courbée dans sa robe de chambre molletonnée, l’embrassa ; ça piquait un peu. Son grand-père, tiré à quatre épingles, austère et taciturne, était attablé devant sa chicorée.
— Bonjour, Frédéric, mon garçon. » Le vieil homme jeta un œil à la médaille cabossée. Pépé était très pratiquant et allait sûrement dire quelque chose de sévère, mais Mamie lui envoya un regard terrible, alors il bafouilla :
— Mamie t’a préparé une tartine, mets-toi à table. » Il se racla la gorge. « Le Papa Noël t’a encore gâté. Nous irons voir le sapin dès que tu auras fini. »
Sa mère vint lui faire un baiser. Frédéric sentit qu’elle avait plus de maquillage que d’habitude, sa joue était poisseuse de fond de teint. Frédéric voulut la regarder, mais quelque chose au fond de lui lui disait qu’il ne valait mieux pas. Il mangea lentement sa tartine trempée dans son chocolat chaud qui coulait sur son menton. Les trois adultes parlaient de l’heure de la messe, du chauffage qu’on devrait remonter, du mal aux reins de Pépé – mais ce n’était pas une conversation comme les autres, car on entendait toujours le tic-tac de l’horloge entre les phrases. Et toujours cette porte qui ne s’ouvrait pas.
Bientôt ce fut l’heure pour Frédéric d’aller coller son nez contre la porte vitrée qui séparait la cuisine de la salle à manger. Dans la pénombre interrompue par le clignotement des guirlandes, il vit qu’on avait mis le Petit Jésus dans la crèche. Il était largement plus grand que les autres santons de Provence qui l’entouraient sous le papier marron. Il faisait au moins deux fois la taille de la vache. Frédéric pensa que c’était un Petit Jésus géant, comme les monstres de Goldorak qui piétinaient les villes entières avec tout le monde qui criait en dessous. Puis il vit les paquets sous l’arbre. Son cœur sautilla quelques instants, puis il repensa à la porte qui ne s’ouvrait pas et dans sa poitrine tout devint lourd à nouveau.
On alluma la lumière et les trois adultes s’assirent sur le canapé en rang d’oignon, souriant à Frédéric. Frédéric remarqua qu’il n’y avait plus le calendrier avec les belles images qu’il aimait bien, à côté du sapin. Mais ce n’était pas le moment de penser à ça et il saisit le plus petit paquet. Il commença à déchirer le papier et, alors qu’il regardait toujours son présent, il entendit ses lèvres dire tout doucement :
— Peut-être qu’on devrait attendre Papa pour ouvrir les cadeaux ? »
Sa mère ouvrit la bouche, émit un bruit minuscule puis elle se précipita dans la cuisine. Elle semblait sur le point de vaciller. La grand-mère de Frédéric la suivit et mit ses bras autour de ses épaules. Le garçon entendit leurs pas dans l’escalier entrecoupés de sanglots.
Il était seul avec son grand-père. Le vieil homme lui dit :
— Ton père ne va pas venir. »
Frédéric continua à déchirer lentement son paquet et découvrit une voiture Majorette. Elle était violette avec des flammes vertes sur les côtés. C’était une qu’il n’avait pas. Il l’avait vue au rayon jouet du supermarché. Elle était terrible. Il aurait voulu la faire rouler partout dans la salle à manger, sur le rebord de la fenêtre, sous la table, la mettre en compétition avec ses autres voitures, et elle aurait gagné. Mais à la place il écoutait ce qu’allait dire son grand-père. Pour l’instant il ne disait rien, mais Frédéric savait que ça allait venir, car Pépé frottait ses vieilles mains sur les cuisses de son pantalon. Enfin il dit :
— Ton père a fait quelque chose de très mal et... et il est en prison, très loin. Il ne reviendra pas. Il faut être fort, mon petit. Tu seras fort, n’est-ce pas ? » fit-il en lui prenant l’épaule.
Frédéric hocha la tête et baissa sa petite tête bouclée.
— Bien. Bien, bien, dit son grand-père, et il lui tapota l’épaule. Eh bien, dis-moi, ça c’en est une, de belle auto. Ah bas, dis-moi. »
Le vieil homme frotta ses cuisses à nouveau.
Frédéric sentait les larmes dans tout son petit corps, mais bizarrement, pas dans ses yeux. Il fit rouler sa voiture sur quelques centimètres sous le sapin, mais cette voiture ne voulait aller nulle part. Il voulut poser une question à Pépé, une ou deux ou mille, mais il sentait que Pépé n’avait pas trop envie qu’on lui pose des questions. Il se dit qu’il les poserait à Maman plus tard.
Trente-deux ans plus tard, ce même môme, couché près de son Sisley à regarder les lumières que les bateaux-mouches projetaient sur le plafond de son grand appartement parisien, sentit la présence de ces questions qu’il n’avait jamais posées. Il avait réussi, le fils du faiseur de calendriers, se disait-il, toujours emmitouflé de son manteau en cachemire ; et en réussissant, il était devenu un autre homme. Plus grand. Comme le Petit Jésus, il était devenu trop grand pour sa famille et ses silences. Alors, il les avait quittés, tous, dès qu’il avait pu. Il avait aimé sa mère, pourtant. Sans le lui dire, bien sûr. Même à son enterrement, les mots n’étaient pas sortis. Il était assez grand pour les dire, il avait vingt-et-un ans à sa mort. Elle avait dû savoir qu’il l’admirait pour l’avoir élevé seule, pour ne s’être jamais remariée, pour l’avoir protégé des tristes décembres... N’est-ce pas ? C’était entendu entre eux, qu’il fallait faire attention aux mots. Plutôt que de parler, il avait travaillé plus dur que les autres, tous les jours, toutes les nuits. Il continuerait de le faire pour l’amour des toiles de maître et des sentiers ascendants. Et il s’était promis de ne jamais, jamais avoir d’enfant ; mieux valait laisser à la postérité des divorces célèbres que des étrennes amères.
Il se releva enfin, courbaturé, et alluma la lumière. Pourquoi ces pensées aigres et si désordonnées étaient-elles venues brouiller son bonheur, ce soir entre tous les soirs ? Il fit un geste brusque comme s’il avait voulu faire fuir des mouches posées sur ses paupières. Il regarda les deux autres trésors de sa collection, et ça le calma. Exposée sur le mur du salon, l’esquisse d’un autre peintre impressionniste, Camille Pissarro : au crayon et à l’encre d’Inde, un carré de carton d’une dizaine de centimètres de haut, un champ en hiver et deux paysans. L’empreinte, dans la neige, de leur quotidien, de leurs pieds et de leur peine. Et dans l’entrée, au-dessus de la console, le triptyque d’Utagawa Hiroshige : trois femmes, sous les flocons épais. Leurs pas dans la neige, les petites traces éphémères d’une balade ordinaire. Il n’était pas Impressionniste, Hiroshige, mais cette peinture avait inspiré Claude Monet qui collectionnait ses estampes. Un jour, Frédéric posséderait les quelques dizaines de millions de dollars nécessaires à l’acquisition d’un Monet, d’un Caillebotte, d’un Gauguin, d’un Sisley majeur, d’une toile de Pissarro. Le caprice des collections, tous les trésors du monde à portée de main, quelle belle invention humaine ! La plupart des gens se contentent de petits riens, Frédéric Solis se payait le goût des grands chefs-d’oeuvre. Mais cette passion pour les paysages d’hiver impressionnistes exigeait de grands sacrifices. Il était prêt à les faire.
Il se dévêtit enfin et accrocha son manteau dans la penderie près de la porte. Les lettres sur la console semblaient vouloir attirer son attention. Il hésita. Il savait ce qu’il y avait dedans. On lui demandait de l’argent. Les sacrifices qu’il avait dû faire pour ses tableaux n’étaient pas encore assez grands. L’appartement était hypothéqué, ses comptes étaient à découvert et il avait commencé à revendre ses antiquités. Mais les créditeurs devraient attendre. Il était Maître Frédéric Solis, l’argent viendrait. Il saisit une lettre en recommandé et soupira. Celle-ci, il faudrait sûrement la payer.
Il ouvrit l’enveloppe et lut la lettre dactylographiée. Celle-ci arborait le cachet d’un cabinet de notaire en haut à gauche. Frédéric haussa les sourcils et les yeux suivirent. Alors ça, se dit-il, ça c’est une bonne nouvelle. On le convoquait pour régler une succession. Un héritage ! Il resta interdit quelques minutes. Puis il sourit de tout son beau visage et respira de toute sa poitrine. Cette nouvelle inattendue viendrait sûrement alléger ses dettes. Un héritage. Jour de chance. Champagne !
Ce n’est qu’après la deuxième gorgée de champagne qu’il se rendit compte qu’il n’avait pas reconnu le nom du défunt. Un homme était mort et faisait de lui son héritier et il n’arrivait pas à se souvenir de lui. Il relut la lettre et chercha le nom du mort : Fabrice Nile.
Fabrice Nile. Il tourna le nom dans sa tête pendant longtemps, fabricenilefabricenilefabricenile, chercha dans ses clients, dans ses connaissances, dans le ciel de Paris qui était devenu tout noir, mais aucun visage n’apparut. Il repensa à ce matin de Noël, mais il n’y avait personne avec ce nom-là, là-bas, non plus.
Il reprit une gorgée de champagne. Demain, il irait chez le notaire et tout serait dévoilé. Il rentrerait chez lui plus riche, son comptable arrêterait de lui dire qu’il était au bord de la ruine, il n’aurait plus à penser à ces gens d’il y a longtemps et tout irait bien.
Tout irait bien.
* * *
Pendant ce temps-là, Madame Boule, la vieille concierge de l’hôtel particulier, sortit pour aller inspecter le local à poubelle, en faisant attention à ne pas glisser sur les dalles du jardin qui se couvraient de blanc. Elle pestait : la secrétaire de l’avocat était gentille, mais elle ne mettait jamais ses sacs dans les bonnes poubelles. On avait beau le lui répéter, il n’y avait rien à faire.
— Et voilà ! Qu’est-ce que je disais ? Le sac noir à côté des cartons ! Ralala… » Madame Boule mit le sac dans la bonne poubelle et retourna à sa loge en serrant les pans de son gilet contre sa poitrine.
Le lendemain, le camion poubelle passerait, emportant avec lui une lettre pour Frédéric, tombée de la console dans le sac noir sans que personne ne s’en aperçoive. Pourquoi cette lettre-là et pas celle du notaire ? Le destin est coquin, parfois.
Á suivre demain...