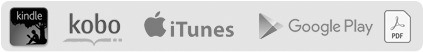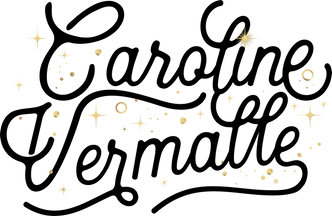Chapitre 163
Bruissements

Le verrou sauta en quelques secondes, dérangeant à peine le calme de la nuit.
Les doigts de Sixtine, entraînés au Vietnam, étaient rapides et précis. Ses pas silencieux coupaient l’obscurité de la maison comme un couteau parfaitement aiguisé.
L’intérieur était si ordinaire qu’il en était suspect. Confort sans luxe – neuf et pourtant déjà fatigué. Souvenirs d’Indonésie, sans valeur. Frigo presque vide. Plafonds bas, parquet usé, murs étroits encadrant une vie sans passion.
Seuls les papillons épinglés dans des cadres ici et là rappelaient qu’un jour, dans cet endroit, il y avait eu de la vie. Leurs ailes iridescentes capturèrent un instant la lumière de la lampe-torche de Sixtine. L’image du papillon bleu dans le Poor Boy’s Inn revint dans son esprit, sans qu’elle pût déceler la nature de cette coïncidence. Encore une connexion floue.
Au bout de la maison, une petite chambre. Son papier peint vieillot était arraché sur une ligne horizontale de plusieurs mètres, à hauteur de hanches. Deux tables de chevet, encombrées de médicaments, de magazines, d’un verre vide. Deux oreillers froissés. Le couple Masseau passait ses nuits ici.
Sur le parquet gisait une valise ouverte. Les vêtements se trouvaient toujours dans la penderie.
De l’autre côté d’un couloir étroit, une salle à manger. Une horloge dorée sur le buffet ciré contenant de la belle vaisselle. Le velours des chaises était intact. Personne n’y allait jamais.
Un portrait sur le mur du couloir. Lucia, se convainc Sixtine. La photo avait été prise au milieu des palmiers, sur le rebord d’une piscine. Elle portait de longs cheveux noirs raides, son visage était fin, mais jovial. Elle riait, prétendant poser comme une starlette, son regard pourtant adouci par la modestie. Elle avait la vie devant elle.
Oh, Lucia, où te caches-tu ?
En moins de cinq minutes, Sixtine avait fait le tour du rez-de-chaussée.
Tout était à sa place, en ordre. La maison d’un couple parti en voyage. Pourtant, quelque chose clochait, et Sixtine s’impatienta : pourquoi n’arrivait-elle pas à comprendre l’anomalie troublant ce paysage domestique ?
Elle passa un doigt sur la table basse en bois peint de noir. Son empreinte traça un trait presque invisible dans la poussière clairsemée.
Elle nota les rayures et le bois arraché sur les encadrements de portes, de la même nature que la cicatrice sur le papier peint de la chambre. Puis elle vit le fauteuil roulant sous l’escalier. Cela expliquait la cicatrice sur le papier peint de la chambre. Mais pour qui était ce fauteuil ?
Elle monta les escaliers ; au centre de chaque lame de bois, des traces d’usure.
Une marche grinça, elle se figea. Elle surveilla lentement le rez-de-chaussée sombre. Elle crut que quelque chose avait bougé dans les ombres, comme un tissu noir qu’on agite dans l’obscurité, mais elle se convainquit que ce n’était que sa lampe.
Soudain, un frisson parcourut sa peau.
L’odeur. L’odeur ne correspondait pas à l’intérieur.
Un parfum ranci jouait à cache-cache derrière celui de la poussière et des meubles qui vieillissaient. Parfois, il se faisait intense, mais dès que Sixtine essayait de l’identifier, il se défilait.
Au premier étage, deux portes donnaient sur un couloir. Deux chambres d’amis, vides. Les amis ne devaient pas venir souvent.
Le faisceau de sa lampe révéla soudain un énorme insecte noir, aussi gros qu’un poing. Sixtine sursauta, avant de découvrir qu’il était épinglé, comme les papillons. Un scarabée à la carapace noire et brillante, la tête ornée d’une longue corne, semblable à celle d’un rhinocéros. Son ventre se contracta au souvenir de Thaddeus.
Troisième porte au bout du couloir : la main de Sixtine hésita avant d’agripper la poignée. Elle avait senti l’odeur étrange, à nouveau. Cette fois, elle resta autour d’elle assez longtemps pour qu’elle lui évoque des images. Une odeur végétale, naturelle, pourtant elle ne pouvait imaginer aucune fleur, aucun arbre avec ce parfum trop âcre. Pourquoi les images de son enfance dans les fleurs des falaises lui revenaient-elles ?
La porte était fermée. Il fallut à Sixtine du temps, de la dextérité et son couteau de nacre pour en venir à bout. Mais ce qu’elle vit derrière la convainquit qu’elle avait trouvé le cœur de la maison, là où l’on cachait les secrets : le bureau de Masseau.
Dommage : quelqu’un était passé avant elle.
Les livres gisaient à terre, certains ouverts, face contre terre. On les avait feuilletés en hâte avant de fuir. Pourquoi s’était-on acharné sur cette bibliothèque si ordinaire ? Rien que des romans de gare, des guides sur l’Indonésie, des manuels pratiques sur les papillons. Qui cela pouvait-il intéresser ?
Du plastique clair et transparent accrocha la lumière de la lampe. Parmi les livres éparpillés sur la moquette se trouvait un boîtier de cassette, comme celles utilisées dans les années 80. Il était vide, mais le contenu inscrit au marqueur sur une étiquette disait :
Sermon Réverend M. Boucvalt, 08.1987.
Le nom résonna de façon étrange dans sa mémoire.
Il y avait quelque chose d’autre sur le boîtier de cassette : des empreintes de poudre d’or.
Elle tourna sa paume et vit que ses propres mains en étaient pleines. Elle balaya le faisceau autour de la pièce en désordre, qui révéla d’autres traces de poudre : sur la poignée, sur la clef, sur les étagères noires. Le bureau était jonché de papiers, documents et photographies, eux aussi rayés de traces d’or.
Soudain, elle vit une image égyptienne, et son pouls s’accéléra. Elle fut déçue de découvrir une brochure pour la vente du vieux tribunal à La Nouvelle-Orléans. Son architecture était dans le style de la pure renaissance égyptienne du XIXème siècle, c’était probablement le projet de démolition dont le violoniste lui avait parlé. Elle l’oublia vite, car sous ses doigts, parmi les autres papiers, elle vit son nom.
Jessica Pryce.
Un frisson glacé la paralysa un instant, et l’odeur âcre se fit plus intense à mesure qu’elle découvrait des coupures de journaux : la disparition des époux Pryce, la découverte de la chambre X. La vente de Néfertiti.
Elle en était certaine à présent. Elle était exactement là où elle devait être.
Elle éteint la lampe, peut-être pour essayer de trouver des réponses dans l’obscurité, peut-être pour interroger son instinct. Ou peut-être parce que le parfum étrange l’avait avertie d’un danger.
Il fallut quelques secondes pour que ses pupilles s’habituent et en soient certaines : un faible trait de lumière rayait le sol. Un mouvement faible animait la clarté qui filtrait.
La pièce sans fenêtre donnait sur une autre porte, cachée derrière le bureau.
Le grenier. Quelque chose bougeait à l’intérieur.
Sixtine, le cœur battant, poussa le bureau pour dégager la porte lorsqu’un bruit au rez-de-chaussée la fit sursauter.
Elle s’immobilisa avant de se recroqueviller. Plusieurs minutes passèrent, à épier le silence et darder l’obscurité. Rien d’autre ne semblait bouger en bas : c’étaient probablement les bruits ordinaires d’une maison dans le bayou, le craquement naturel du bois, ou l’intrusion d’un petit animal. Elle aurait pu rester plus longtemps, tapie dans l’obscurité du bureau, jusqu’à ce qu’elle comprenne la source du bruit, qu’elle s’assure qu’il n’y avait aucun danger.
Mais dans le silence, elle avait décelé autre chose : un bruissement provenant du grenier. Comme un soufflement saccadé, comme le vent dans les branches qui murmure avant la tempête.
Elle en était sûre, il y avait quelque chose de vivant dans le grenier.
Avec une infinie délicatesse, elle ouvrit la porte.
L’odeur âcre et sucrée emplit directement sa gorge, menaçant de la faire tousser. Les escaliers étaient couverts d’une pellicule morne, de poudre d’or mêlée à de la poussière noire et de la crasse du bois.
Elle sortit son couteau de nacre. À mesure qu’elle approchait, l’odeur et le murmure s’intensifièrent. Le mouvement aussi.
Pourquoi pensait-elle à des fleurs que l’on torture ?
Lorsqu’elle ouvrit enfin la porte, le monde tout entier sembla se jeter sur elle.
Ses cheveux gris, sa peau, ses bras qui protégeaient son visage, tout son corps fut assailli par les caresses de l’air.
Des milliers de papillons colorés tourbillonnaient dans le vaste grenier, attirés par les ampoules d’une guirlande. Ils étaient bleus, ils étaient verts, ils étaient bruns, tous exotiques, tous extraordinaires. Mais ceux qui dominaient ce ballet prodigieux avaient des ailes d’or.
Ils étaient si grands qu’ils dessinaient des ombres gigantesques sur les murs.
Des milliers d’épingles, traversant le corps immobile de papillons de toutes tailles, formes et couleurs, couvraient un côté du grenier. Des étagères en métal, cachant le morceau de contre-plaqué cloué à la fenêtre, croulaient d’innombrables bouteilles de verre contenant des ailes. Au plafond, en parallèle des guirlandes d’ampoule, étaient tirés des fils lourds de centaines de pinces à linge. Dans chacune de ces pinces, une chrysalide. Dans les coins, des plantes à moitié mangées par les chenilles. Tapi derrière les murmures des papillons, le son des gouttelettes des arroseurs.
Sur le sol, si nombreuses qu’elles couvraient l’intégralité du vaste grenier, des ailes brisées.
La beauté des papillons dans leur prison sordide coupa le souffle de Sixtine et sembla ralentir le temps. Des bruits provenaient d’en bas ; peut-être crut-elle que c’était son cœur étouffé de tristesse qui battait trop fort. Instinctivement, sa main serra le couteau de nacre, mais son âme, son âme hypnotisée par le ballet sublime, déchirée entre l’émerveillement et le désespoir, étourdie de dégoût pour ce crime contre l’innocence et le merveilleux, son âme essayait d’arracher du ciel la liberté et la justice et la leur rendre en un souffle.
Dans l’obscurité d’un coin du grenier, elle décela soudain un papillon de nuit, plus grand que tous les autres. Ou était-ce une chauve-souris ? Il y avait quelque chose de brillant au bout de ses ailes bigarrées de noir et d’argent. Sur son corps était dessiné un motif complexe, comme un crâne, ou un motif aztèque.
Elle voulut s’en approcher, tendant son bras en face d’elle pour fendre l’immense rideau grouillant de papillons.
Mais à mesure qu’elle s’approchait, l’insecte se retirait dans l’obscurité.
Puis elle sentit quelque chose sur son doigt. Un large papillon aux ailes d’or, aussi grand que sa main, comprenant peut-être qu’elle était sa dernière chance, se posa sur la peau de Sixtine.
Une femelle, pensa-t-elle. Pendant un instant, toutes deux se figèrent dans une parfaite immobilité.
Des larmes se formèrent dans les yeux émeraude.
Les bruits s’intensifièrent. Des bottes dans les escaliers. Des hommes approchaient.
Le grenier n’avait aucune issue.
Sixtine serra son couteau de nacre si fort que ses jointures devinrent blanches. Tout son corps était prêt à se battre, et il savait se battre. Mais la main sur laquelle reposait le papillon doré ne voulut pas bouger, de peur de rompre cette connexion si précieuse.
L’instant d’après, Sixtine était entourée d’hommes avec des masques et des armes à feu, pointées droit sur sa tête.
Son couteau de nacre tomba sur le sol jonché d’ailes brisées, et fut en un instant couvert de la poudre d’or des papillons morts.
Lorsque l’un des quatre hommes masqués hurla aux autres de fermer toutes les issues, le papillon s’envola, rejoignant la mêlée aérienne autour des ampoules de la guirlande. Quelle fuite les inquiétait : la sienne ou celle des insectes ?
Les inscriptions sur leurs gilets pare-balles lui apportèrent la réponse : trois d’entre eux portaient le sigle de l’US Fish and Wildflife Service, le quatrième celui de l’US Customs and Border Protection. Des officiers des douanes, spécialisés dans le trafic d’espèces sauvages.
— Ne bougez pas ! aboya l’homme le plus proche de Sixtine. Vous êtes au milieu de plusieurs centaines de milliers de dollars d’insectes.
— Chef !
L’un des co-équipiers tenait délicatement entre des pinces le grand papillon aux ailes d’or qui s’était posé sur le doigt de Sixtine. Il le déposa au creux des mains gantées du douanier, qui l’observa pendant plusieurs secondes. Ses yeux brillaient.
— Un obsidia. Correction : un million de dollars.