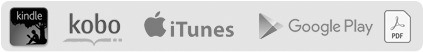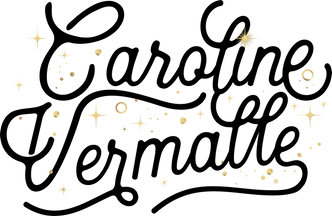Chapitre 179
Tana Toraja

Dernier quartier de lune (10ème jour d’octobre)
Sixtine s’agrippait au tableau de bord et serrait les dents.
Le conducteur roulait vite sur la petite route en lacets qui longeait falaises de karst et précipices. Il n’hésitait pas à donner des coups de volant pour éviter un chien, des enfants, ou une famille entière sur un scooter.
Les villages perchés à flanc de montagne apparaissaient puis disparaissaient, laissant place à des forêts de bambous, des rizières éclatantes ou des plantations de cacao. Et les papillons voletaient partout.
Lorsqu’ils arrivèrent enfin à un grand village, ils passèrent d’abord des maisons d’apparence moderne en béton de couleur pastel. Mais bientôt, Sixtine découvrit ce qu’elle cherchait, surgissant fièrement de la canopée de bananiers et de palmiers : les tongkonan, majestueuses maisons ancestrales.
Dans cette partie du village, ces structures sur pilotis de bambou, leurs gigantesques toits incurvés comme des navires fantasmagoriques, étaient rutilantes. Les cornes de buffles d’eau clouées sur leurs façades semblaient avoir été astiquées, les décorations colorées fraîchement peintes. Les maisons étaient organisées en rangée autour de pelouses impeccables.
Sixtine était émerveillée.
L’image de la serveuse du Poor Boy’s Inn s’invita dans son esprit. Ce paysage aurait comblé ses rêves de voyage, le dépaysement était si total qu’il exigeait qu’on lâche prise pour se donner à lui. Être dans le présent, et l’aimer tout entier : n’était-ce pas ce que chacun cherchait ? Dans un hôtel-restaurant crasseux de Louisiane, une jeune femme s’évadait sur les ailes d’un papillon épinglé.
Sixtine était bien certaine que Lucia aussi, qui avait grandi dans les montagnes d’une île au bout du monde, avait rêvé d’évasion. L’homme aux papillons avait été son ticket pour une vie meilleure.
Son ventre se serra. Pourvu qu’il ne soit pas trop tard.
Le conducteur s’arrêta pour demander son chemin à une jeune femme à l’allure moderne, portant un voile violet. Après un court échange où Sixtine comprit à sa grimace qu’elle ignorait la réponse à ce que lui demandait le conducteur, elle héla un vieil homme édenté qui portait un sac de riz. L’échange avec le vieillard fut plus long et occasionna quantité de gestes désordonnés, mais au bout de plusieurs minutes, le conducteur se remit en route.
— Là où votre ami vous a donné rendez-vous, dit-il, c’est un autre village un peu plus loin. Pawa’satori. Il n’est pas sur les cartes, mais les anciens connaissent le chemin.
La route pour s’y rendre était plus étroite, plus accidentée et si escarpée que Sixtine crut ne jamais y parvenir. Mais enfin, après avoir traversé une rivière couleur de terre à même son lit, ils découvrirent les imposantes silhouettes des tongkonan.
Ici, les pelouses paraissaient moins vertes, les toits moins rouges, les navires moins fiers. Les buffles gras circulaient librement au milieu des maisons, se délectant des flaques de boue de l’allée principale. Un vague air de délabrement flottait autour de ce petit village – ou étaient-ce les nuages gris qui soudain voilaient le soleil ?
Sixtine trouva immédiatement Max qui attendait, adossé à un bâton de bambou auquel était attaché un cochon. L’animal hurlait, et l’architecte, les bras croisés, le considérait avec méfiance. Le visage de Max s’illumina dès qu’il aperçut Sixtine, et il trotta jusqu’à la voiture pour l’accueillir.
Elle fut ravie d’apprendre que son sourire n’était pas juste dû à son arrivée : il était sur une piste.
— Tout Pawa’satori prépare les funérailles des grands-parents de Lucia. Une grosse affaire, car son père est chef de clan. Elles commencent dans trois jours, et se dérouleront sur au moins une semaine. Je suis certain que Lucia est prisonnière quelque part ici, et que Masseau a organisé une cérémonie secrète qui se produira au moment où tout le village célébrera l’enterrement.
Il s’approcha d’elle et ajouta tout bas.
— Sa famille pense qu’elle est toujours aux États-Unis, mais il est prévu qu’elle arrive d’un moment à l’autre, comme tous ses cousins, pour les funérailles.
— Ils ont des nouvelles d’elle ?
— Pas depuis deux semaines, mais il n’y a pas de réseau, ici. Ils sont confiants : rien ne pourrait empêcher Lucia de venir à cet enterrement. À Toraja, tu peux trouver une excuse pour ne pas aller à un mariage. Mais un enterrement… c’est ce que les gens attendent toute leur vie, les vivants comme les morts. Et c’est justement à cause de ça que je pense que Masseau va en profiter.
— OK, dit Sixtine. Explique-moi.
Sixtine et Max déambulèrent le long de l’allée principale. Ils se faufilèrent entre les stands de bambou croulant sous les bananes et le cacao, et dérangèrent quelques canards. Sixtine s’efforça d’ignorer plusieurs garçons menant des buffles qui semblaient fortement intrigués par ses cheveux argent. Et toujours, ils étaient dans l’ombre des tongkonan, dressées contre les caféiers et les palmiers comme des sentinelles méfiantes.
— On dirait des bateaux, dit Sixtine, pensive.
— Les Toraja viennent du sud-est de l’Asie, ils ont migré sur l’île de Sulawesi par bateau, c’est peut-être pour ça.
Il s’arrêta, les considéra.
— On dit aussi que ce sont les bateaux qui vont vers leur paradis mythique. Le chemin des ancêtres passe par le cosmos.
Il soupira, puis reprit :
— La mort et les pratiques funéraires sont au cœur des croyances du peuple Toraja. Elles remontent à sept cents ans, et peut-être même bien jusqu’à la préhistoire. Les gens ici peuvent être modernes, urbains, chrétiens ou musulmans, mais ils suivent les coutumes qu’on appelle aluk todolo, le « chemin des ancêtres ». Pour les Toraja, la mort n’est pas un événement brutal et définitif, au contraire, elle fait partie d’un long et lent chemin.
Leur balade les amena à une zone du village où les maisons paraissaient modernes. C’était l’heure du déjeuner. Des familles prenaient leurs repas, des fenêtres sortaient les échos de leur bavardage et des bruits de casseroles.
— Tu vois ces gens, là ? Ils nous ressemblent, c’est une famille comme les autres. Mais dans la chambre, il y a peut-être un cadavre. Une grand-mère momifiée au formaldéhyde, habillée de sa robe de nuit, portant ses lunettes, les cheveux peignés. On va lui apporter quatre repas par jour, avec le thé de l’après-midi.
Sixtine observa le quotidien qui coulait doucement dans le village autour d’elle. Des odeurs de porc grillé et d’encens émanaient des maisons. Rien de macabre, rien de triste. Juste la vie ordinaire qui continue. Un couple souriant passa en scooter, un chien avec un bandana autour du cou entre leurs jambes.
— Cette grand-mère, continua Max, on la garde à la maison des semaines, des mois, parfois des années après le décès. Pendant cette période, on dit qu’elle est makula, qui signifie « celle qui est malade », ou « celle qui dort ».
— Celle qui dort. Comme la Belle au bois dormant, dit Sixtine, pensive.
— C’est tout à fait ça. Et même après les funérailles, personne ne meurt jamais vraiment. Un lien particulier unit les vivants et les morts ; c’est un lien différent de celui qui unit les vivants, mais c’est une connexion tout aussi profonde. Et un enterrement, c’est une grande fête qui rassemble tout le village, et la plus fastueuse des célébrations de la vie.
Ils bifurquèrent vers des escaliers étroits chaulés de blanc et bordés de bougainvilliers. Ils montèrent l’un après l’autre.
Sixtine comprenait les explications de Max, et cette connaissance secrète qu’elle avait à l’intérieur d’elle-même confirmait qu’il disait vrai. Cependant, quelque chose manquait. Comme s’ils passaient à côté de l’essentiel, comme si un détail important n’avait pas encore été révélé et attendait son tour, dans l’ombre.
Bientôt, ils arrivèrent à un bâtiment en forme de tongkonan : un restaurant qui surplombait le village. Max continua de grimper, le long d’un petit chemin escarpé. Quelques mètres plus haut, ils parvinrent à un plateau qui leur offrait une vue panoramique sur Tana Toraja.
Les rizières en terrasse d’un vert vif se déclinaient en surfaces argentées qui reflétaient le ciel bigarré de gris. Les pics des montagnes au loin se perdaient dans le coton anthracite des nuages. Une rivière couleur de boue traversait de part en part le paysage immense. Au loin, de la fumée noire se mêlait à la couleur du ciel.
Un éden tourmenté, pensa Sixtine.
À ce moment précis, deux grands papillons virevoltèrent autour d’eux. Mais Max, qui les ignora, scrutait un point juste sous leurs pieds, à droite.
— Il y a une autre dimension à ces funérailles.
— Laquelle ? demanda Sixtine.
— Le pouvoir. Regarde.
Ils s’avancèrent un peu plus près du bord, et découvrirent une sorte de stade, délimité par des poteaux de bambous. C’était la source du bruit : des dizaines de jeunes hommes criaient depuis des estrades branlantes, et la musique techno encourageait leurs cris.
Au milieu, deux buffles d’eau se faisaient face, cornes contre cornes. Sur leurs corps gras, on avait peint des noms en lettres colorées.
— Les buffles d’eau sont les stars des funérailles Toraja. Ça, c’est le tedong silaga, le combat de buffles, qui fait partie des nombreux événements avant le début des cérémonies. Mais ce n’est pas une corrida, c’est juste pour mesurer leur force. La mise à mort est réservée pour les funérailles. Ils vont être sacrifiés en grande pompe. Plus on a sacrifié de buffles pour un défunt, plus il sera prospère dans l’au-delà.
— C’est le trésor, murmura Sixtine.
— Exactement. Chacun paie son buffle, c’est une preuve de statut social. Un animal coûte vingt millions de roupies. Pour l’enterrement des grands-parents de Lucia, soixante-dix-sept buffles ont été prévus. C’est un enterrement à cent cinquante mille dollars.
— Et un sacré bain de sang…
— Hmm. Et devine qui a fait, il y a un mois, la plus grosse donation ? Avec un buffle albinos, le plus rare, qui vaut des centaines de millions de roupies ?
Sixtine tourna la tête vers Max. Ses yeux brillaient lorsqu’il répondit :
— Jeremy Masseau.