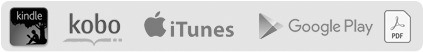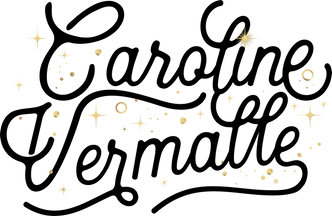17 décembre

— Oui, en 1979, le 7 décembre exactement, continua Ernest. La toute nouvelle Fondation Monet s’était installée dans sa maison à Giverny et j’y allais pour négocier la reproduction dans le calendrier 81 de quelques-unes de ses œuvres. Je me revois encore, attendant devant la grille verte. Il faisait un vent glacial et je me souviens d’avoir regretté de ne pas avoir de gants. C’était un hiver si rude... Un peu comme celui-ci.
Et Ernest regarda par la fenêtre, comme s’il revoyait le ciel au-dessus de Giverny cet hiver-là.
« Une jeune femme ouvrit la grille, m’annonça que la dame avec qui j’avais rendez-vous avait du retard à cause de la neige, mais me priait d’attendre à l’intérieur de la maison. Malgré le froid, je lui demandai si je pouvais attendre dans le jardin. J’avais hâte de le découvrir, étant un admirateur de toutes les toiles que le grand homme avait produites ici. Le public, à l’époque, n’était pas autorisé à le visiter. La jeune femme parut gênée un instant, mais accepta. J’entrai alors dans la propriété et fit mes premiers pas dans le jardin de Claude Monet.
Ce que je découvris me causa un choc.
Je vis devant moi la désolation la plus cruelle. Le jardin n’était pas seulement abandonné. Il était dévasté. Les ronces étouffaient les bosquets, les mauvaises herbes couvraient les allées, des branches pourries gisaient au pied des arbres morts. Les serres n’avaient plus de vitres, la mousse sale recouvrait les débris de verre et d’ordures, la rouille souillait les treillis. À mesure que j’avançais dans les allées désordonnées, je découvris l’étendue terrible de la dévastation. Rien n’avait survécu. Mais ce n’est qu’en arrivant devant le pont japonais que mon cœur se crispa : il était bien là, le petit pont du grand chef-d’œuvre, triste vestige d’étés perdus, vidé de ses couleurs, trempant telle une charogne dans une eau noirâtre où flottaient une chaussure sans lacet et un poisson mort.
J’errai comme une âme en peine dans ce cimetière végétal. Je revis tous les printemps de mes calendriers, les iris et les nymphéas, les roses et les glycines, mais ce jardin, lui ne voyait que le temps qui était passé. La destruction était si totale et le paysage si décharné qu’on aurait dit que le temps s’était vengé : pour qui se prenait cet homme, ce Monet, qui avait voulu rendre ce jardin éternel ? Voilà ce qu’on faisait aux jardiniers qui se prenaient pour des artistes.
Je me hâtai vers la maison, maudissant mon manque de fortune – combien j’aurais voulu acheter ce bout de terre pour lui rendre sa poésie que le temps avait dérobée. Mais qu’y pouvais-je, moi, vendeur de calendriers ? C’est alors que je vis, les genoux dans la neige sale, un homme qui grattait la terre. Je remarquai qu’autour de lui, dans un périmètre de deux mètres ou trois, les parterres étaient redevenus propres. Un petit arbuste respirait, libre de ronces, les pieds dans de la terre toute fraîche. L’homme se retourna. Il me vit. Il m’observa quelques secondes. Son visage était brillant de sueur, il avait des yeux gris sous de larges sourcils bruns, la mâchoire en avant et des oreilles légèrement décollées rougies par le froid. Sa coupe de cheveux, courte et impeccable, et ses joues rasées de près, semblaient être passées de mode depuis vingt ans, alors qu’il devait en avoir trente au plus. Pourtant, n’importe quelle femme aurait dit que c’était un bel homme. Il me sourit et son sourire m’apparut soudain familier – nous connaissions-nous ? Mais avant que je puisse me souvenir si j’avais dans mes relations un jardinier, il se retourna sans un mot et se remit à son travail.
La dame que je devais rencontrer était arrivée. Nous nous mîmes d’accord rapidement, le rendez-vous fut un succès. Je me permis alors de parler du jardin. Elle partagea ma frustration et ma peine, mais me confia qu’elle était optimiste : la Fondation avait rassemblé les fonds de mécènes américains et les travaux allaient bientôt commencer pour tenter de rendre au jardin son lustre disparu. Ce serait un projet de longue haleine, mais heureusement, Claude Monet avait assez d’admirateurs pour que le jardin puisse renaître après plus d’un demi-siècle d’abandon.
"D’ailleurs, continua-t-elle, nous avons ici un admirateur, que dis-je, un amoureux du jardin. Un Américain, l’un des premiers à avoir fait une donation, avant même que la Fondation n’existe. Ce monsieur s’est même formé à l’horticulture pendant deux ans pour pouvoir participer aux travaux. Vous l’avez peut-être vu, il débroussaille du côté du pont japonais. Depuis cet été, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, il est à son poste, deux heures par jour. Les gens de Giverny le prennent un peu pour un fou, mais je vais vous dire, Monsieur, si un jour le public peut venir visiter le jardin tel que Monet l’a peint, ce sera grâce aux excentriques comme ce gentleman."
Je lui demandai la permission de rester dans le jardin encore un peu, et elle me l’accorda.
Ernest s’arrêta et regarda ses mains. Sans les quitter des yeux, il murmura :
« Depuis plus de trente ans, je me demande chaque soir ce qu’aurait été ma vie si je n’étais pas retourné dans le jardin.
Frédéric attendit un petit moment avant d’ouvrir l’enveloppe. Il regarda autour de lui. Il était seul. Il ouvrit le pli avec prudence et en sortit un document. C’était un plan du Musée d’Orsay, le dépliant qu’on donnait aux touristes. En le dépliant il vit, inscrit au marqueur rouge, une croix sur la salle 29 du niveau 5, un numéro (RF 1984 64) et un rendez-vous : 14 heures.
La croix rouge se trouvait sur l’étage des Impressionnistes. Le contraire l’aurait étonné.
Mais s’il avait le privilège d’une visite privée à Giverny, il n’en serait pas de même pour Orsay. Il y serait la veille de Noël à une heure de grande affluence : le musée serait plein à craquer.
Il regarda au verso de la feuille et y trouva la même écriture rouge. Mais plutôt qu’une calligraphie appliquée comme sur les tickets, traînaient des mots écrits en hâte, comme si on y avait couché une pensée de dernière minute : « Un tableau de grande valeur vous attend, soyez au rendez-vous ».
On dit que le meilleur moyen de se cacher c’est de se mêler à la foule. Il repensa à sa théorie d’une rencontre avec des malfrats lui proposant un tableau volé. Il l’avait oubliée, cette possibilité, au fil des trains et des bateaux, car bien entendu, l’idée était tirée par les cheveux. Mais il ne pouvait pas s’empêcher de trouver dans cette enveloppe comme une odeur de danger, qu’il n’avait pas ressenti jusqu’alors. Et puis, c’était le dernier rendez-vous. C’était là que tout se jouait. Dans quarante-huit heures.
Il appela Jamel. Pas de réponse.
La sensation de froid, accentuée par la fatigue, commençait à raidir ses membres ; mais il ne pouvait pas partir sans avoir exploré le reste du jardin. Surtout le jardin d’eau. Il marcha à travers les allées froides, et enfin, vit les saules pleureurs qui délimitaient le royaume aquatique lové dans le parc. Et il le vit. Le petit pont japonais, avec son vert éclatant, tellement joyeux au milieu de ce paysage d’hiver. Il réalisa que c’était le pont sur le dessin de Fabrice Nile. L’eau du bassin reflétait le ciel, et c’était comme si un tapis de nuages menait le visiteur vers un trône coloré, celui du maître, qui un jour y était passé. Frédéric s’arrêta, toujours enchanté, regrettant de ne pas avoir des yeux assez grands pour croquer le jardin tout entier. Il goûta le silence. Sans le savoir, il se recueillait. Il tentait de rentrer en communion avec l’artiste révéré, le maître des lieux, mort et enterré au cimetière de Giverny derrière l’église. Comment expliquer, alors que Frédéric pouvait le voir sur ce petit pont, sa grande silhouette barbue perdue dans la contemplation de son royaume aquatique ?
Un oiseau cria, un engin se mit à rugir au loin et Frédéric réalisa que la silhouette sur le pont n’était pas Monet, mais un individu en chair et en os. Mais le temps d’arriver sur le pont, il avait disparu.
Pétronille était inquiète. Ernest semblait être épuisé. Il toussait de plus en plus fréquemment. Cette conversation l’essoufflait. Pourtant, elle sentait qu’il avait besoin de parler. Elle se souvint de ce qu’avait dit le docteur. L’homme devant elle n’avait plus que quelques semaines à vivre. Devait-elle l’écouter ou rompre le charme et l’encourager à se reposer ? Mais dès qu’il ouvrit la bouche encore, son histoire la happa à nouveau.
— Je retournai dans le jardin. L’Américain était toujours là. Sans me retourner, je l’entendis dire avec un fort accent américain :
— "Avez-vous la main verte, comme on dit ici ?
— À mon grand regret, non, répondis-je. D’autres font les jardins, moi je ne fais que les admirer.
— Ah. Alors vous avez l’œil vert. On peut dire cela ?
Je ris et il se retourna.
— Oui, dis-je, je pense qu’on peut le dire. J’entends que vous vous êtes lancé dans une grande entreprise.
Il retourna à ses semis et me dit, le dos tourné.
— Êtes-vous un artiste ?
— Non, non. Là encore, je ne suis qu’admirateur.
— Mes parents voulaient que je suis peintre. Ils aiment beaucoup la peinture. Ma grand-mère, avant qu’elle est morte, avait des peintures de Monet. J’étudiais beaucoup, les couleurs, la lumière, mais moi, je ne suis pas né avec le talent, you understand ? Je suis venu ici, à Giverny. J’espère que le talent me trouve ici, mais non. C’est le jardin qui me trouve. Alors, je jette mes pinceaux, et je prends ça pour faire les couleurs et la lumière", fit-il, me montrant sa petite serfouette.
— "C’est difficile de croire que ce bout de terre était un jour le jardin de Monet, fis-je, pensif.
— Mais il faut croire, fit-il me regardant droit dans les yeux. Il faut croire, mon ami.
Il se releva.
— Regardez, là, le clos normand. Elles sont là, les couleurs, sous l’hiver. It’s like a sketch... un croquis, vous savez ? Les nymphéas, elles reviendront un jour. Peut-être deux ans, dix ans, cinquante ans, il faudra. Le temps n’a pas d’importance, il faut croire.
Il me regarda, enleva un gant et fouilla dans la poche de son manteau taché de terre.
— Tenez, look.
Il sortit de sa poche un document troué à force d’avoir été plié et déplié. C’était un immense plan du jardin, et ses bras écartés pouvaient juste le déplier. Dessus, il avait peint des copies des tableaux de Monet. Il y avait aussi, collées délicatement, des photos de l’époque du peintre et des photocopies d’extraits de ses lettres. Il y avait inscrit en calligraphie élégante le nom des saisons : Winter, Summer, Spring, Fall. Puis d’autres mots comme Fleeting, Serendipity, Eternal, Joy puis une inscription qui me parut japonaise. Et au milieu, il y avait un cœur rouge, comme un cœur ardent, celui de Notre Dame des Jardins peut-être.
Il replia le document et fit, avec fierté.
— Ce jardin a existé parce que Monet l’a imaginé. Il a aimé ce qu’il voyait dans... dans l’invisible, you understand ? Jamais il n’a arrêté de croire que ce bout de terre devient ce jardin un jour. Moi aussi j’imagine et je crois, pour faire naître le jardin encore. Ça, c’est comme ma carte de trésor. Il faut croire, et on trouve le trésor.
Oui, les couleurs étaient revenues et je commençais à pouvoir imaginer ce que l’artiste avait vu, ici même, il y a longtemps. Je lui dis :
— Je ne me suis pas présenté. Ernest Villiers.
L’homme serra la main que je lui tendais et répondit en souriant :
— Simon Offenbach.
Á suivre demain...