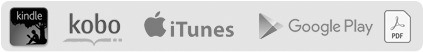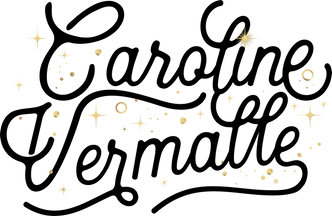23 décembre

Pétronille était en pyjama dans son appartement. Vingt minutes plus tôt, elle avait parlé avec Jamel. Puis elle avait demandé conseil à Dorothée. À présent, elle était seule devant son ordinateur. Elle avait écrit un email à Frédéric, sous la dictée de Jamel. Maintenant, il lui fallait cliquer sur le bouton « Envoyer ». Mais elle hésitait. Était-ce la bonne chose à faire ? Était-ce juste, charitable, bienveillant ? Jamel ne lui avait pas forcé la main. Il avait été clair sur le fait qu’elle ne devait le faire que si elle était confiante, qu’elle ne le regretterait pas ensuite. Il avait promis qu’il n’y avait pas de mensonge dans ce message. Elle le croyait, mais... Sa souris survola un instant le bouton. Elle ne cliqua pas. Elle relit le message pour la vingtième fois :
Cher Frédéric
Je vous écris, car je viens de recevoir des informations sur Fabrice Nile. Elles viennent un peu tard, mais peut-être vous seront-elles utiles.
Même s’il était connu des services sociaux en tant que Sans Domicile Fixe, il semblerait que Fabrice Nile ait résidé au 25 villa de Saxe, Paris 75007, par intermittence entre 1995 et 2012. Ce qui est notable est que l’un des résidents de cette adresse est un Simon M. Offenbach. M. Offenbach, d’origine américaine, est référencé sur maints sites web comme étant l’un des premiers mécènes de la Fondation Claude Monet à Giverny, sa famille établie à New York ayant possédé plusieurs toiles du peintre jusque dans les années 40. Il semblerait que M. Nile et M. Offenbach aient cohabité de 1995 à 2001 (décès de M. Offenbach). J’ai vérifié, il s’agit bien d’une seule et même habitation dans un hôtel particulier, et non pas d’appartements séparés. Vous trouverez en pièces jointes une facture au nom de M. Nile et plusieurs articles sur M. Offenbach.
En vous remerciant à nouveau pour la référence que vous avez eu la gentillesse d’écrire et en vous souhaitant bonne continuation,
Bien à vous
Pétronille
Pétronille attendit encore, fit le tour de son appartement, regarda sa carte au trésor et cliqua sur « Envoyer ».
De l’autre côté de Paris, Frédéric ouvrait sa messagerie électronique. Les mots « 25 villa de Saxe, 75007 Paris » lui sautèrent aux yeux. C’était l’adresse à laquelle il avait retourné l’enveloppe, jamais ouverte, que lui avait envoyée son père dix-sept ans plus tôt.
Au volant de sa voiture, Jamel était en route pour le Musée d’Orsay. Il était coincé dans les embouteillages. À la radio, on parlait du périphérique bloqué à cause de la neige, cette neige qui n’était pas tombée comme ça depuis plus d’un siècle. Mais Jamel n’écoutait pas. Il repensait à Ernest. Ernest, paralysé de douleur, qui, après avoir entendu Jamel lui dire qu’il allait tout de même au Musée d’Orsay, avait demandé à l’accompagner. Bien sûr, il s’y était opposé. Ernest était à peine capable de marcher jusqu’à la porte de sa chambre, alors le Musée d’Orsay.... Jamel avait eu des mots avec Gilles, qui, lui, voulait qu’on laisse Ernest y aller, qu’il valait mieux crever au Musée d’Orsay que dans un lit d’hôpital. Il s’emportait en parlant d’acharnement thérapeutique. Jamel avait serré les dents et remis Gilles à sa place. La vérité était qu’il ne savait pas si Frédéric allait venir et qu’il ne pouvait pas prendre le risque d’affliger cette dernière déception à Ernest.
Mais ce qui l’attristait le plus, c’était ce que lui avait dit Ernest le matin même. Il avait parlé de paix. Jamel ressentait une certitude terrible. Qu’aujourd’hui était le dernier jour. Il essayait, Jamel, de toutes ses forces, de rejeter cette intuition. Mais elle était là quand même.
Marcia Gärtener gara son coupé sur le parking de l’hôpital. Elle avait promis à Jamel qu’elle réfléchirait et elle avait réfléchi. Ernest Villiers était le grand-père de son enfant. Elle se rappelait ses propres grands-parents, dont elle chérissait le souvenir. Elle voulait annoncer à cet Ernest qu’il allait être grand-père, surtout après l’injustice qui avait bouleversé la vie de cet homme. L’histoire de Jamel l’avait touchée. Ce monsieur était terriblement malade, au moins, sa visite lui ferait plaisir... Oui, elle avait bien fait de venir. Si ce n’étaient ces crampes qu’elle sentait au-dessus de l’aine depuis le matin.
Elle se présenta à la réception et quelques minutes après, frappait à la porte de la chambre 312. Silence. Elle frappa à nouveau. La porte était ouverte, elle la poussa.
Devant elle se trouvait un lit défait. Vide. Des affaires personnelles étaient encore là, mais il n’y avait personne. Jamel lui avait pourtant dit qu’Ernest ne pouvait plus quitter son lit et que les docteurs avaient arrêté les interventions. Ernest Villiers était-il... mort ?
Cette pensée serra son ventre. Mais avant qu’elle n’ait pu questionner les infirmiers, Marcia sentit son jean devenir tout chaud. Elle regarda ses pieds. Ils étaient trempés. C’était comme si on avait ouvert un robinet sur elle. Elle perdait les eaux.
Il est un petit bout de Seine où, si on tend l’oreille, été comme hiver, on peut distinguer le refrain des guides des Bateaux-Mouches « ... sur votre droite, le jardin des Tuileries, le plus grand et le plus ancien jardin à la Française de notre ville.
Et sur votre gauche, mesdames et messieurs... » et une centaine de paires d’yeux découvre un bâtiment clair, gigantesque et magnifique, paré d’étendards colorés excités par le vent... « Le Musée d’Orsay ».
Parmi les touristes des Bateaux-Mouches, certains font escale ici. Ils montent les escaliers depuis les quais et rejoignent les autres nombreux curieux qui font la queue pour voir ses trésors. Et sous l’horloge immense qui orne la façade, ils ont l’air de fourmis.
Une fois à l’intérieur, le visiteur doit ajuster son regard. Le hall principal est si vaste qu’il semble défier les règles de la gravité. Oui, un jour on prenait des trains ici. Aujourd’hui, on y prend de l’émerveillement pour toute une vie. On y flâne, en désordre, se perdant entre les sculptures nées des doigts des plus grands. Puis on finit toujours par monter les escaliers de fer, par s’approcher de la grande horloge. C’est là que se trouve l’or d’Orsay : la plus grande collection d’œuvres Impressionnistes au monde.
C’est là qu’a lieu la magie. Dans les autres musées du monde, on y va pour découvrir. Parfois même pour apprendre. Mais pas ici. Ici, on reconnaît. Qu’importe d’où on vient, ici on retrouve de vieux amis. La petite danseuse étoile de Degas, le bal de Renoir, la chambre de Van Gogh. C’est comme si, eux et nous, on avait des souvenirs communs. Celui-là, il était dans la salle à manger de l’oncle Paul, avant qu’il vende sa maison. Le déjeuner sur l’herbe de Manet, les cathédrales de Monet, l’été de Pissarro. Celui-là, je l’avais sur mon agenda, ma dernière année de fac. La neige de Sisley, les Tahitiennes de Gauguin, les oranges de Cézanne. Celui-ci, c’était le préféré de Maman, te souviens-tu ? On pourrait les tutoyer, tellement on les connaît, et tellement on est heureux de les voir ici. Et dire que ce sont les vrais.
On flâne, on se faufile entre les autres visiteurs, on regarde de près. On aimerait les toucher, comme pour serrer la pince à l’artiste. Mais on n’a pas le droit, alors on prend une photo sans flash.
Et il n’est pas rare qu’entre tous, un de ces tableaux amis nous retienne et nous invite à rester un moment de plus. Oh, ce tableau aussi on le connaît, on l’a vu plein de fois. C’est une petite toile qui semble vouloir nous dire quelque chose à l’oreille. On ralentit. On se pose devant, des fois en penchant la tête. Puis on devient tout silencieux à l’intérieur.
Le temps d’un regard, on oublie le départ du Bateau-Mouche, le mal au pied, et même l’horloge gigantesque qui tique au-dessus de nos têtes. Mais tout passe, même les instants de grâce. Il faut y aller, si on veut voir le reste de Paris. Mais de retour chez nous, on pourra dire que la plus belle peinture du Musée d’Orsay, c’est cette petite toile toute pâle, toute douce. « La Pie » de Claude Monet.
« La Pie » de Monet voyait les gens passer. S’arrêter, puis repartir. C’était comme ça ; elle le savait bien, elle, que tout passait. Mais cet après-midi-là, il y avait un homme qui la regardait et ne partait pas. Lui aussi se souvenait de ce tableau. Oh, oui, il se souvenait. Il avait les poings serrés et le cœur qui battait comme une bombe à retardement. Cet homme était Frédéric Solis. Il était 14 heures précises, dans la salle 29 du niveau 5. Sous « La Pie », un numéro : RF 1984 64.
À quelques pas derrière ce visiteur intense se tenait quelqu’un qui voyait dans l’ombre de Frédéric la silhouette d’un petit garçon en pyjama de flanelle. Quelqu’un qui avait encore un peu de paix à faire, quelqu’un que des amis avaient amené là parce que c’était le seul endroit de la Terre où il devait être, avant de partir ailleurs. Quelqu’un qui oubliait la douleur de son sang malade et avançait vers cet homme-enfant. Son enfant.
À l’hôpital de Pontoise, des sages-femmes palpaient la belle demoiselle qui avait perdu les eaux dans la chambre du patient échappé. Marcia pouvait entendre des conciliabules derrière la porte ; la plupart des termes, elle ne les comprenait pas, mais on parlait aussi d’un accident sur le périphérique, de la neige qui s’était remise à tomber. Finalement, un docteur arriva dans la chambre, lui sourit et lui dit que ce serait trop risqué pour elle de rentrer à Paris, avec cette météo imprévisible et la perturbation des transports en Île-de-France, mais qu’on s’occuperait bien d’elle ici. Voulait-elle avertir le père qu’elle allait accoucher ici ? Marcia objecta, prise de panique. Il était hors de question que ce soit qui que ce soit qui l’accouche autre que son médecin qui l’avait suivie depuis le début de sa grossesse. Ne pouvait-elle pas prendre une ambulance pour rejoindre la clinique parisienne où il pratiquait ? Le docteur cessa de sourire. On appellerait son médecin, mais elle ne devait pas quitter cette chambre. Car le bébé ne se présentait pas bien.
Frédéric fixait le tableau. C’était comme s’il était pris d’une fièvre, ses sens en ébullition et son corps pétrifié. La foule se pressait devant « La Pie ». Comme un flux et un reflux, la vague tiède des étrangers qui se frottaient à lui puis laissaient la place à d’autres. Il entendait des bribes de conversation qui naissaient près de lui puis s’évanouissaient aussi vite. Il serrait les dents et il n’osait regarder personne.
Frédéric Solis avait peur.
Et soudain, dans les bruits de la foule, il entendit une voix qui semblait venir de très loin.
« C’est comme si le peintre te disait, vite, vite, regarde ces couleurs que le ciel nous donne. Vite, vite, cueille ces belles choses et garde-les dans ton cœur. Vite, vite, aime ce jour qui passe. Vite, vite, avant que la pie ne s’envole. »
C’était son père ! C’était sa voix, il s’en souvenait, à présent ! Quand ils regardaient ensemble les calendriers, ce père oublié lui soufflait les messages mystérieux que les peintres avaient cachés sous les couleurs. Frédéric, petit garçon ordinaire à qui les géants parlaient, il s’en souvenait subitement, ces secrets délicieux qu’ils épelaient, à travers la voix de son père, juste pour lui. Et ce décembre-là, ce décembre de malheur, c’était « La Pie », dans le salon près du sapin. Oui, c’était lui et Frédéric se retourna pour le chercher, mais un groupe de touristes chinois l’encercla. Frédéric se mit sur la pointe des pieds et ses yeux écarquillés cherchèrent partout dans la salle l’homme qu’il avait vu pour la dernière fois plus de trente ans auparavant. Il y avait un père de famille indien, des retraités dans un groupe, un gardien du musée qui s’endormait sur une chaise, des businessmen en cravatent, mais tous ces hommes n’étaient pas son père. S’était-il volatilisé comme en ce Noël 79 ? Il croisa bien le regard d’un vieillard infirme aux yeux humides, et il aurait voulu lui demander : avez-vous vu mon père ? Mais à ce moment-là, d’un côté de ce couloir sublime, immobile au milieu de la foule, il vit Jamel. Dans sa main, une mallette en cuir.
Jamel ne voyait pas Frédéric qui se pressait vers lui. Il regardait derrière Frédéric, de l’autre côté de l’enfilade de pièces, Ernest qui marchait quelques pas pour suivre avec ses béquilles ce fils qui s’échappait à nouveau. Il savait, Jamel, combien de force d’âme il fallait à cet homme pour faire ces quelques pas. Mais alors que Frédéric était presque arrivé devant lui, Jamel vit les jambes d’Ernest s’effondrer lentement. Gilles et Bertrand avaient surgi de derrière la cloison de la salle d’après et le retinrent dans sa chute. Ernest murmura quelque chose dans l’oreille de Bertrand, qui hésita, et regarda Gilles. Puis les trois hommes s’éloignèrent dans la foule. Mais avant que Jamel puisse voir où ils se dirigeaient, Frédéric s’était posé devant lui. Il n’avait rien vu de ce qui s’était joué derrière lui.
Jamel le regarda sans pouvoir dire un mot. Tout ce qu’il avait répété, il l’avait oublié. Il se contenta de lui tendre la mallette et enfin lui dit :
— C’est à toi.
— En échange de quoi ? fit Frédéric.
— Rien. En échange de rien.
Jamel allait partir, mais s’arrêta dans son élan et dit :
— Peut-être que dans quelques heures, tout ça n’aura plus de valeur. N’attends pas.
Á suivre demain...