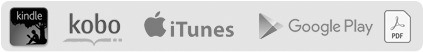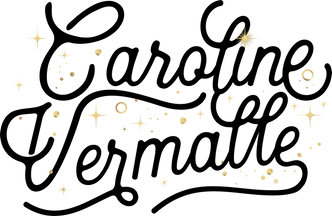4 décembre

Pétronille était dans une cabine d’essayage, en culotte et soutien-gorge dépareillés. Elle tentait de passer une robe bleue qui menaçait d’être une taille trop petite. Elle s’était plainte de n’avoir rien à se mettre pour la soirée des 40 ans de mariage de ses parents. Elle avait encore plein de temps, mais Dorothée – qui avait déjà sa tenue – avait dit qu’il fallait le faire aujourd’hui. Dorothée n’était pas du genre à faire les choses à la dernière minute. Et Pétronille écoutait toujours Dorothée.
Son téléphone portable affichait 13h08. Elle était au beau milieu de sa pause déjeuner. Elle avait déjà fait des heures sup’ cette semaine et on était seulement mercredi midi. Mais il n’y avait rien à faire : Pétronille se sentait aussi minable d’être dans cette boutique de l’avenue Montaigne que si elle avait piqué dans le portefeuille de Frédéric. Elle avait déjà perdu assez de temps avec ces histoires de fringues. C’était ici, dans cette boutique, ou jamais. Il fallait que la robe aille.
Alors qu’elle se débattait toujours avec son vêtement, elle se demanda pourquoi elle se sentait si coupable. « C’est en arrêtant d’essayer d’impressionner votre entourage que vous pourrez enfin vous épanouir ». Elle avait lu ça dans un horoscope quelconque et c’était resté dans sa tête, car c’était sûrement vrai. Elle voulait toujours impressionner tout le monde. Elle avait commencé des études de droit pour impressionner son père, alors que sa vocation, c’était la pâtisserie. Si elle avait fait monter Dorothée dans l’appartement de Frédéric, c’était, pour être honnête, pour impressionner sa sœur. Et plus que tout, elle voulait impressionner Frédéric. Parce que Frédéric avait quelque chose qui poussait les gens à vouloir l’impressionner et parce que, jusqu’à maintenant, elle avait été très loin d’être impressionnante. Parce qu’il était bel homme. Parce que tout lui réussissait et parce qu’elle en pinçait pour lui. Oh non, elle l’avait pensé ! Elle remua la tête pour faire partir cette pensée embarrassante – surtout alors qu’elle était à moitié nue. Non, non, non, je ne suis pas amoureuse de Frédéric.
La deuxième raison de cette culpabilité aigüe était ce Fabrice Nile. Le dossier vide.
Le bras en l’air, la robe coincée au-dessus de la poitrine, l’autre bras essayant de descendre une fermeture éclair au dos déjà descendue au maximum, la tête rejetée en arrière par peur de mettre du fond de teint sur la soie azur et les yeux fermés suppliant « il faut pas que ça craque, il faut pas que ça craque » : c’est dans cette position que la sonnerie de son téléphone portable trouva Pétronille. Elle ouvrit les yeux, contorsionna tout son corps vers son sac à main, réussit à libérer une main et agrippa le téléphone portable. C’était Frédéric.
Il n’y avait aucune possibilité technologique pour que Frédéric puisse la voir, à ce moment précis, coincée dans cette boutique huppée, en sous-vêtements délavés et avec la marque des chaussettes sur ses mollets blancs. Mais, juste au cas où, Pétronille prit la décision agonisante de ne pas répondre. Son gros orteil saisit son jean et le posa délicatement sur le téléphone portable pour étouffer la sonnerie.
— Nini, ça va ? » c’était Dorothée qui s’impatientait.
— Euh, c’est encore trop tôt pour le dire, mais je suis optimiste » fit Pétronille, qui arriva enfin à faire passer la robe au niveau de la poitrine. Mais il y avait toujours le problème des hanches. Et le problème de Frédéric aussi. Déjà un « bip bip » signalait un message dans sa boîte vocale. C’était une agonie. Elle s’arrêta de respirer et tira un dernier coup pour faire descendre la robe qui daigna enfin passer. Maintenant la robe était toute froissée et Pétronille était en sueur. Elle regarda le résultat dans le miroir. Aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Puis elle se ressaisit, rentra le ventre, redressa la poitrine, mit ses cheveux en chignon, arqua le dos, plia une jambe, se cambra, fit la moue, se mit de profil, posa une main sur une hanche, l’enleva, fit semblant de rire à un compliment imaginaire, se tint sur la pointe des pieds, défit ses cheveux et se contorsionna pour regarder son derrière. Trois kilos. Quatre, juste pour être sûre. Dix jours avant la soirée. C’était possible. Il fallait juste se mettre au régime maintenant tout de suite et commencer par ne rien manger aujourd’hui.
— Alors ? demandait Dorothée.
— Parfaite. Je la prends, répondit Pétronille toujours dans le salon d’essayage.
— Ben, fais voir.
— Nan, nan, mais là... » objecta Pétronille.
Mais Dorothée avait déjà ouvert le rideau et regarda sa sœur avec des yeux ronds.
— Nan, mais là, tu me vois, je suis pas bien maquillée et puis je viens de manger un sandwich, alors forcément ça me boudine, mais c’est bon. Il faut que je file, Frédéric a appelé. » Elle avait déjà commencé à enlever sa robe.
— Mais attends, fit Dorothée, tu peux pas partir avant d’avoir choisi tes chaussures...
— Ah oui, zut, les chaussures... »
D’ordinaire, Pétronille adorait le shoe shopping – car qu’importe son poids, les chaussures allaient toujours. Mais elle avait une boule dans le ventre rien que de penser au message de Frédéric. Elle vit que Dorothée avait bien compris qu’elle voulait partir le plus vite possible et Pétronille se sentit – si c’était possible – encore plus coupable : ce moment était privilégié entre les deux sœurs et tout ce à quoi Pétronille pouvait penser était son satané boulot. Heureusement, Dorothée était tout aussi sensible aux émotions de sa sœur, et lui fit doucement, en s’asseyant à côté d’elle dans le salon d’essayage :
— Ben alors, ma Nini, toi qui adores acheter des chaussures... C’est quoi qui te chiffonne ? »
À ces mots, Pétronille se dégonfla comme une baudruche. Courbée dans sa robe bleu azur avec l’étiquette qui dépassait du dos, elle déballa tout à Dorothée. Qu’entre la fac et le mi-temps avec Frédéric, elle travaillait comme une acharnée, semaine ET weekend. Qu’elle avait mille et une choses stupides à faire, des trucs qu’une stagiaire de seize ans pourrait se coltiner, comme les photocopies, la gestion de sa collection d’art, la maintenance de son site web, les notes de frais, l’organisation de ses déplacements, les paperasses pour le comptable, ses costards au pressing, acheter un nouveau chargeur pour son iPhone (« Trois heures rien que l’aller-retour à l’Apple Store, tu y crois, toi ? »). Que Frédéric lui donnait à faire des trucs pourris comme appeler ce client insupportable, Witherspoon, pour confirmer des rendez-vous, alors que ce devait être la responsabilité de sa secrétaire chez DentressengleEspiardSmith (« qui j’en suis sûre gagne trente fois plus que moi ») Et elle se décarcassait jusqu’à ne plus dormir et ne plus manger (« ça ne se voit pas comme ça, mais j’ai sauté plein de repas »), mais Frédéric ne voyait toujours que les choses qui n’allaient pas. En plus, elle rougissait à chaque fois qu’elle le voyait, c’était hyper embarrassant et pas impressionnant du tout. Elle lui dit son refus pour les jours de congé avant la soirée-surprise pour ses parents. Puis cette idée, qu’elle avait eue, de proposer de faire une pièce montée de quatre-vingts choux et nougatines pour l’occasion – elle n’aurait jamais le temps de le faire. Et en parlant de gâteau, la cerise, c’était ce dossier Fabrice Nile.
Un mec – mort en plus – venu de nulle part, sur lequel son boss voulait tout savoir et ça avait l’air très important. Elle ne savait même pas pourquoi elle devait récolter les infos parce qu’il n’apparaissait sur aucun des dossiers de Frédéric. Elle n’avait aucune piste. Rien sur Google, rien dans les journaux, rien dans les annuaires. Elle avait même cherché sur Facebook, sans succès. C’était comme si ce mec n’avait jamais existé. En plus, elle n’avait aucune autorité légale pour demander les informations confidentielles vu qu’il ne faisait pas partie d’une affaire en cours. Demain matin, elle devait rendre son dossier. Son dossier vide.
Dorothée, qui avait tout écouté sans broncher, lui dit enfin :
— Écoute. Je te propose un deal : Toi, tu oublies tout ça pendant – et elle regarda sa montre – quarante-quatre minutes. Pendant ces quarante-quatre minutes, tu éteins ton téléphone, tu t’éclates et tu choisis ici même les chaussures les plus extraordinaires que tu puisses trouver. Moi, de mon côté, et c’est ma part du deal, je t’aide pour ton dossier Fabrice Machin. On le fait à deux. Veux-tu être mon alcolite ?
— OK, murmura Pétronille dans un petit sourire timide. Elle mit sa tête sur l’épaule de sa sœur. Tu es la meilleure sœur du monde. »
Dorothée prit le téléphone de Pétronille, l’éteignit et dit avec autorité.
— Fais-moi voir cette robe. »
Pétronille se redressa et prit la pose. Dorothée l’inspecta avec le plus grand des sérieux et dit enfin, avec un grand sourire fier :
— Impressionnante ! »
Quarante-quatre minutes plus tard, Pétronille sortit avec un sac qui contenait des escarpins fabuleux et les conseils précieux de Dorothée. Pour le dossier de demain, elle dirait juste qu’elle était sur une piste prometteuse, mais qu’il était encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Et dès demain, elle irait fouiner du côté de Pontoise, dans cet hôpital où ce Fabrice Nile avait passé les dernières semaines de sa vie. Elle allait mettre les mains dans le cambouis, Pétronille, mais ça allait être bien.
Le cœur plus léger, elle ralluma son téléphone portable juste avant d’arriver à la station de métro. Quand elle entendit le message de Frédéric, ses épaules retombèrent. Argh ! Il lui demandait de faire l’une des choses qu’elle détestait le plus : appeler John Witherspoon avec une mauvaise nouvelle. Il allait mal le prendre, c’était sûr : Frédéric annulait le rendez-vous de ce samedi et lui demandait de le reprogrammer pour lundi. Comme elle détestait ce Witherspoon ! Il prétendait traiter Frédéric comme son fils ; son vrai fils devait être alors bien à plaindre. Elle n’avait pas le cœur d’appeler Witherspoon maintenant. Elle le ferait plus tard au bureau.
Ce n’est qu’au moment de passer les tourniquets du métro qu’elle réalisa que c’était la première fois que Frédéric annulait un rendez-vous avec un client.
Frédéric regarda sa montre : 21h46. Il était assis dans un fauteuil moderniste, sa chemise de smoking ouverte sur son torse, les yeux dans son Sisley. L’email de Pétronille s’affichait sur l’écran de son smartphone, posé sur sa cuisse. « Je suis sur une piste... ». 21h47. Quand allait-il trouver le courage d’appeler Dany pour lui dire qu’il ne viendrait pas ce soir ?
Dany Simonet avait divorcé de son mari de trente-cinq ans, la même année où elle avait été couronnée « Actrice préférée des Français » par le Télé Star pour son rôle dans une série policière de TF1 – six ans auparavant. Depuis, elle affichait son sourire botoxé de soirée en soirée, qu’elle et son nouvel époux, de vingt ans son cadet, organisaient la plupart. Frédéric avait réglé son divorce et son contrat prénuptial ; depuis, elle insistait qu’il soit à ses côtés à toutes ses fêtes et ne se privait pas de flirter avec lui quand elle avait trop bu. C’était grâce à elle que cinq ans plus tôt, Frédéric avait rencontré Marcia – elle, qui, pourtant, n’aimait pas les soirées. Mais on ne refusait pas une invitation de Dany ; son carnet d’adresses comptait le who’s who du showbiz. Et ce soir, elle avait personnellement envoyé un message à Frédéric pour lui dire qu’elle avait une surprise. Mais ce soir, pour la première fois depuis qu’il la connaissait, il allait décliner l’invitation. À la dernière minute. Elle serait fâchée. Mais demain, il lui enverrait Pétronille avec une gerbe de fleurs monumentale et un petit mot flatteur et tout serait oublié. Il appela Dany, fut soulagé d’avoir son répondeur et prétendit un ennui de santé.
Il se leva pour prendre un paquet de cigarettes dans le tiroir de la console. Il fumait parfois en soirée, mais ne s’autorisait jamais de cigarette chez lui. Ce soir, il ne pouvait pas s’en empêcher. Il alla jusqu’à la fenêtre, et les volutes de sa cigarette dansèrent devant la ville scintillante. La vérité était que depuis le rendez-vous du notaire (ou était-ce la réception du Sisley ?) il avait été pris d’une étrange fatigue particulièrement handicapante. Il n’avait pas dormi depuis quatre nuits et avait beaucoup de mal à se concentrer au bureau. C’est sûr, il vieillissait. Il était habitué à travailler quatorze heures par jour, six jours par semaine depuis l’université, il aurait quarante ans l’année prochaine. Combien de temps pouvait-il continuer à ce rythme-là ? Il lui fallait des vacances. Il allait à Monaco pendant le Grand Prix, à Saint-Tropez ou à Deauville quelques weekends d’été, à Gstaadt ou à Verbier quelques weekends d’hiver – mais c’était professionnel, des déplacements nécessaires pour élargir son network – il était d’ailleurs souvent l’invité de Dany, de John ou d’autres clients généreux. Il s’autorisait seulement des échappées à New York lors des grandes ventes de tableaux impressionnistes chez Christie’s – serrant les dents à la vue d’autres, immensément plus riches que lui, remporter des Monet et des Van Gogh à quinze ou vingt millions de dollars. Un jour, ce serait lui. Un jour, il vivrait à nouveau le bonheur intense ressenti lorsque le commissaire-priseur à Sotheby’s avait adjugé vendu « Snow at Marly » Alfred Sisley à 530 000 dollars à Mister Frédéric Solis. Un jour, lui aussi pourrait faire un signe de la main à Londres ou à New York devant un Monet. Tout ce qu’il avait à faire était de continuer à travailler plus dur que les autres et entretenir son carnet d’adresses.
Il réalisa alors que, deux fois dans la même semaine, il avait manqué à son mantra de ne jamais annuler un rendez-vous avec ses clients. Il se sentait coupable, bien sûr. C’était cette culpabilité qui l’avait amené à demander à Pétronille de reporter Witherspoon, plutôt qu’à Catherine, sa secrétaire légale chez DentressengleEspiardSmith. Sa réputation devait être préservée. Frédéric Solis n’annulait jamais ses rendez-vous, point barre.
Alors, pourquoi ce manquement soudain ? Ce n’était pas que la fatigue. C’était une conviction absurde, irrationnelle et dangereuse qui le tenaillait et qui revenait sans cesse : l’idée que Fabrice Nile l’amènerait à un tableau impressionniste.
Il ne voulait pas y penser et pourtant il y pensait. Ça arrivait bien, qu’on retrouve des chefs-d’œuvre dans les greniers. Particulièrement les œuvres des peintres de la fin du XIXème siècle ou du XXème, qui moisissaient chez des gens qui, tellement habitués à les voir, n’en reconnaissaient plus la valeur. Par exemple, la maison de Pissarro avait été vandalisée pendant la Guerre de Prusse, des dizaines de toiles avaient disparu. Les retrouverait-on un jour ? Cependant, dans cette catégorie on trouvait rarement les Monet justement parce qu’ils étaient devenus si célèbres.
Mais ce qui le froissait était plutôt une deuxième conviction. Il voyait dans le nom de Fabrice Nile un autre nom en filigrane. Le seul nom qui jetait des ombres sur sa vie. Le seul nom qui épelait mystères et silence. Le seul... le seul qui le faisait se réveiller la nuit. Frédéric écrasa sa cigarette dans le cendrier Hermès, prit son téléphone et écrit un email à Pétronille.
« Re. dossier Fabrice Nile. Merci d’enquêter connexion possible avec ERNEST VILLIERS. »
L’email était à peine parti que son téléphone sonna : c’était Dany. Il le laissa sonner. Il prit sa carte au trésor, se rassit dans son fauteuil et se mit à rêvasser, les yeux dans les gribouillis minuscules de Fabrice Nile. Ils avaient une façon de lui parler, ces dessins, au-delà de leur mystère. Ce trait pourtant désordonné avait une certaine grâce, une beauté rugueuse qui faisait oublier la mauvaise qualité du papier. Frédéric observa longtemps la grande feuille posée sur ses genoux, puis son regard se brouilla ; les trois nuits sans sommeil le rattrapaient.
Mais tout d’un coup, il devint alerte et ouvrit les yeux en grand : dans un coin du dessin, à côté de la main d’un vieillard, il y avait un point noir, comme sur une partition de musique. Il s’en approcha. Ce n’était pas une note, mais une pie sur une barrière, dans un paysage enneigé. Frédéric n’avait aucun doute, de détail provenait de l’un des tableaux les plus connus de Claude Monet : « La Pie ».
Á suivre demain...