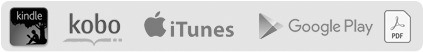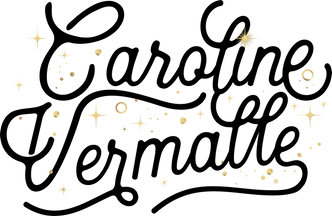5 décembre

Pour la quatrième nuit consécutive, Frédéric n’arrivait pas à dormir. Sur son réveil digital, 23:59 devint 00:00 et le 14 décembre devint le 15. Une autre porte qui s’ouvre sur un calendrier de l’Avent, se dit-il.
Et soudain, il avait devant les yeux le 5 décembre 1979, dans une petite maison d’un bourg de Normandie. C’était un dimanche, parce qu’il y avait L’École des Fans dans le téléviseur en noir et blanc et que Frédéric avait le droit de regarder. Sa mère faisait le repassage et Pino Latuca accompagnait au piano le psschh du fer.
La porte d’entrée grinça. « C’est moi ! J’en ai trouvé un grand ! » Frédéric détala de la banquette pour aller trouver son père, embarrassé d’un sapin de Noël qui faisait deux fois la taille de l’enfant. « Ils viennent juste de les recevoir chez Mammouth, j’ai pris le plus beau. »
Sa mère ne leva pas les yeux, mais marmonna « oh la, la, il va y avoir des aiguilles partout ». Effectivement, l’arbre avait laissé derrière lui une trainée d’aiguilles, de petites branches et de terre, jusque dans la salle à manger.
Frédéric aida son père à installer le sapin dans le coin entre la cheminée et la petite bibliothèque aux portes vitrées, sur laquelle se trouvait le téléphone, l’annuaire et, punaisé au mur, le calendrier. Puis ils se dirigèrent tous les deux vers la remise, où son père, juché sur un escabeau, descendit le carton avec les décorations de Noël.
Cet après-midi-là, Frédéric était tout absorbé à la décoration du sapin, et son père aussi. Mais de temps en temps, quand sa mère venait avec son petit balai ramasser les aiguilles et les fils argentés des guirlandes, ils parlaient de choses de parents. Ils continuèrent alors que sa mère installait la crèche et Frédéric nota juste, dans sa petite tête d’enfant :
— Non, tu ne peux pas aller chez le dentiste mardi, disait son père, c’est le jour où je dois aller à Giverny et je vais rentrer tard. Je te l’ai dit avant-hier. En plus, je l’ai marqué sur le calendrier pour ne pas que tu oublies. Regarde. »
Il pointait du doigt vers le calendrier ouvert sur la page de décembre, où une main d’enfant avait aussi griffonné « Papa Noël » sur le 25.
— Qu’est-ce que tu vas y faire, à Giverny ? demanda son épouse.
— Exactement ce que je t’ai dit avant-hier : c’est pour le calendrier 81. Roger veut y mettre « Les Meules de Foin » de Monet, tu sais, le peintre. Il faut négocier avec les héritiers et comme on n’est pas loin de Giverny, mieux vaut le faire en personne. C’est Roger qui a fixé ce rendez-vous. Frédéric, attention de ne pas t’électrocuter avec la guirlande électrique. Tiens, laisse-moi faire, mon garçon. »
Et Frédéric se souvint, trente-deux ans après, que l’image du calendrier au-dessus du téléphone, qui représentait le mois de décembre, était « La Pie » de Monet.
De l’autre côté de Paris, dans son studio du 12ème arrondissement où elle travaillait tard, Pétronille reçut le message de Frédéric. Ernest Villiers. Le nom lui disait quelque chose, mais elle ne pouvait pas le replacer. Tous les clients de Frédéric avaient une renommée quelconque, elle avait sûrement vu le nom de Villiers dans un article de journal. Elle nota Villiers/FNile sur sa longue liste de choses à faire et sursauta à la lecture du nom Witherspoon souligné en rouge : elle avait oublié de l’appeler pour reporter le rendez-vous. Demain matin, première heure, sans faute : pour ne pas l’oublier, elle souligna son nom au marqueur orange.
Pétronille était épuisée, mais elle ne trouvait pas le courage d’aller se coucher. Alors, elle surfait sur le net, sa joue affalée sur son poignet, son coude en équilibre sur une pile de documents. Elle pensait à la soirée des quarante ans de mariage de ses parents. Oh, il n’y avait rien de très luxueux, c’était chez Dorothée, à la bonne franquette. Sauf que, Dorothée faisait toujours les choses en grand et son appartement, qui était déjà chic, serait transformé en un palais fabuleux. Dorothée lui avait dit qu’elle avait prévu une personne de plus. C’était à cause de l’horoscope, elle y tenait. C’était absurde, bien sûr. Comment Pétronille pourrait-elle rencontrer quelqu’un en huit jours ?
Malgré tout, Pétronille s’imaginait au bras d’un homme. Un homme, grand, brun, brillant, aux manières impeccables, en smoking... Les autres invités lui demanderaient comment sont les soirées chez Castel avec Dany Simonet...
Pétronille se redressa tout d’un coup, et essaya de s’extirper de cette pensée embarrassante. Il fallait vraiment qu’elle aille au lit. Surtout que demain – ou plutôt ce matin – elle aurait besoin de toute sa concentration, pour aller enquêter au fameux hôpital de Pontoise.
Samedi 15 décembre, 10h50, Gare Saint-Lazare. Frédéric pressait son ticket dans sa main froide et attendait, le cou tendu comme tant d’autres, sous le grand tableau des départs de la gare Saint-Lazare. La gare ne ressemblait en rien à celle qu’avait peinte Monet en 1877 : les volutes de vapeur bleues, les nuances vert-de-gris, la poésie, tout avait disparu. Priait-il pour que ce train n’arrive jamais ? Les chiffres du tableau changèrent en même temps que les haut-parleurs annoncèrent que le train à destination d’Eragny-Neuville était prêt à l’embarquement quai 12. Frédéric sentit son estomac se tordre. Il se dirigea le long du quai, plus lentement que tout le monde. Il fut heurté par une valise à roulettes trop pressée. Voiture 12, 2ème classe. Voilà. Il n’avait plus qu’à monter. Et s’il était en danger ? Allait-il se jeter dans un guet-apens mortel ?
Il regarda autour de lui, mais que cherchait-il ? Un visage familier ? Quelqu’un qui l’épiait, peut-être ? Un tueur à gages derrière un kiosque ? Mais tous les voyageurs étaient absorbés par leur voyage, pratiquement déjà arrivés avant même d’être partis, l’anxiété d’un inconfort quelconque étant la seule concession au moment présent.
C’est alors que Frédéric montait le marchepied du train Intercités que toutes ses nuits d’insomnie vinrent assaillir son corps et sa tête. Il se sentait très fragile tout à coup. C’était comme s’il accédait à une réalité qui n’était plus la sienne. Il pénétrait l’imprévu.
Il arriva à la place notée sur le billet. Côté fenêtre. Quelqu’un était déjà installé sur son siège. Un adolescent, dix-sept ans tout au plus, bonnet de laine cousu d’une tête de mort, tatouages et jeans déchirés, écoutait son MP3 – la musique qui émanait de ses écouteurs était tellement forte que tout le wagon profitait du zinzin. Frédéric soupira. Il n’avait aucune patience pour les enfants ; particulièrement pour ceux qui se prenaient pour des adultes, et encore moins pour ceux qui se prenaient pour des durs. Il lui tapa sur l’épaule.
— Excusez-moi, c’est ma place.
— Ah, excusez-moi, Monsieur. Pardon. »
La politesse du garçon, à laquelle Frédéric ne s’attendait pas, lui fit regretter sa sévérité. Alors qu’il prenait la place que l’adolescent lui cédait, il répondit :
— Je vous en prie. »
L’échange avec son voisin lui avait momentanément fait oublier son malaise. Mais à présent qu’il était installé et que le contrôleur annonçait la fermeture des portes, plus de demi-tour possible. Pour se donner de l’importance, il pianota sur son smartphone. Bientôt plus de batterie. Il essaya de se concentrer sur son agenda électronique. Pétronille avait oublié de lui confirmer la nouvelle date pour le rendez-vous avec John. Et le rapport Fabrice Nile ? Il lui envoya un email laconique la pressant de lui présenter les résultats de ses recherches lundi matin au plus tard. Décidément, la performance de Pétronille laissait beaucoup à désirer ces derniers temps. Mais même cette pensée ne réussit pas à le distraire bien longtemps. Il scruta les autres passagers. Personne ne lui prêtait attention. Les voyageurs étaient tous parfaitement placides et indifférents, bercés par l’illusion d’une connaissance absolue de ce qu’ils allaient trouver à l’arrivée de ce train.
La fenêtre du train fit défiler les paysages de banlieues, les tags et les dépôts abandonnés. Si différent, se dit-il, du temps des Impressionnistes, que les trains à vapeur emmenaient vers les guinguettes des bords de Seine. Le roulement régulier menaça d’avoir raison de la fatigue. Il fut tiré de sa rêverie par l’adolescent à côté de lui.
— La musique ne vous dérange pas ?
— Non, ça va », mentit Frédéric.
Après une pause, le garçon fit :
— J’ai besoin de son dans ma tête. Parce que là, je vais voir mon père.
Frédéric sourit poliment, espérant tout bas que son voisin s’en tiendrait là.
— Je l’ai jamais vu, mon père. Ça m’a pris un moment pour le retrouver, mais maintenant que je sais où il est, je le lâche plus. Il avait l’air content que je vienne le voir. Il habite à Argenteuil. Moi, je suis jamais sorti de Paname. Mais Argenteuil, c’est pas si loin. Dire qu’il était là toute ma vie, si près, c’est juste un ticket de train. Ça m’a couté que dalle avec ma carte de réduction. Moi qui le croyais, je sais pas moi, genre à Tombouctou. »
Tombouctou fit rire l’adolescent.
— À un moment, il faut chercher sa vérité personnelle, mec. Vous connaissez Platon, le philosophe ? On l’étudie en cours, les autres, ils disent que c’est lourd, moi je trouve ça intéressant. Il disait qu’on passe sa vie dans une grotte et qu’on voit que les ombres. Que les ombres, et il a pas tort, les ombres, c’est plus facile à gérer que la vérité. Mais il faut aller chercher sa vérité personnelle, au-delà des ombres. C’est ça, qu’il dit Platon.
Moi, j’aurais été content de me dire qu’un jour, je l’aurai vu, mon père. On se dit toujours qu’on va le faire demain et la philosophie de remettre tout à demain, j’y ai goûté aussi. Mais le Big C, ça vous remet le calendrier en place. »
Et soudain Frédéric vit que sous le bonnet, il n’y avait pas de cheveux. Le Big C, le cancer.
— Oh, je devrais m’en sortir, je suis un guerrier. Mais je me suis dit, que j’allais pas me tirer d’ici sans avoir trouvé ma vérité personnelle, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, voilà, Argenteuil. Je vous gonfle avec mes histoires. Je gonfle tout le monde, les potes, ils en ont ras le bol de m’entendre avec ça. En fait... j’ai un peu les jetons. Mais bon, même si c’est un psychopathe, le père, je fais ça pour moi, pas pour lui. Mais pour ma vérité personnelle. »
L’adolescent rangea son MP3 dans la poche de son jean et ce geste révéla son bras tatoué : autour d’arabesques asiatiques, le mot TRUTH en calligraphie gothique. Ces arabesques attirèrent l’attention de Frédéric – les avaient-ils vues quelque part ?
— Si j’ai les jetons, c’est parce que... en fait, j’ai plus peur que ce soit quelqu’un de bien, vous voyez ? Regretter le temps perdu, tout ça...
— Oui, je comprends », fit Frédéric malgré lui, presque sans réfléchir. Mais oui, comme il comprenait, Frédéric. L’adolescent le regarda avec des yeux reconnaissants, puis s’esclaffa :
— Mais bon, vu les goûts de ma mère, ça sera plutôt un psychopathe. Allez, bon voyage, Monsieur. »
L’adolescent se leva, prit son sac et disparut dans le couloir du train. Frédéric força son émotion à rester dans son ventre pour ne pas empoisonner sa tête. Il se sentait encore plus vulnérable. Mais c’est alors qu’il se souvint où il avait vu ces arabesques. Sur le dessin de Fabrice Nile.
Autour du mot VÉRITÉ, perdues dans le fouillis et les minuscules détails du dessin, oui, il en était sûr à présent, il y avait ces arabesques. Fabrice Nile avait forcément vu ce tatouage et substitué le mot vérité par sa traduction anglaise : truth. Fabrice Nile avait voulu qu’il rencontre ce garçon. Il se leva d’un bond et se précipita dans le couloir – que bloquait à présent une grand-mère embarrassée d’une grosse valise et d’une petite fille. Frédéric s’excusa, mais l’allée était exigüe et l’horizon du couloir se brouilla d’autres passagers qui arrivaient à contresens. Le contrôleur annonçait la gare d’Argenteuil. « La Gare d’Argenteuil »... Monet l’avait peinte aussi. Sous la neige.
Il avançait encore, mais ne voyait plus l’adolescent. Le train s’arrêta en gare, Frédéric descendit du marchepied et scruta le quai : même là, il ne le voyait plus. Devrait-il continuer son voyage jusqu’à Eragny ou suivre cette piste ? La gare d’Argenteuil, comme toutes les petites gares, avait sûrement une seule sortie. S’il courait maintenant, il pourrait le rattraper et lui poser des questions.
« Mets ton pas dans celui des Refusés »... Non, l’énigme ne l’aidait pas, les peintres avaient peint aussi bien Argenteuil qu’Eragny. Et retarder ce garçon pour le rendez-vous important avec ce père qu’il ne connaissait pas ? La sonnerie qui avertissait de la fermeture des portes retentit dans sa tête. Il remonta dans le train et retourna à sa place.
La vérité personnelle. Les paroles de l’adolescent résonnaient dans sa tête. Truth. N’était-ce pas ce qu’il avait fui ? Encore une dizaine de minutes avant l’arrivée à Eragny et il essaya très fort, du plus fort qu’il pouvait, de ne pas penser à son père. Ce père qui n’était jamais revenu après ce jour de Noël 1979. Mais un jour, alors qu’il était déjà adulte, une lettre était arrivée. Une enveloppe en papier délicat, une écriture penchée et une adresse au dos. 25 Villa de Saxe – 75007 Paris, il s’en souvenait encore. Ce n’était pas une prison. Frédéric aurait pu être cet adolescent qui prenait des trains pour connaître sa vérité personnelle. Mais c’était bien trop tard. Le temps avait passé – trente-deux ans. Douze mille jours qui avaient effacé, petit à petit, le faiseur de calendriers. Douze mille nuits pendant lesquelles un petit garçon se répétait qu’il fallait être fort et oublier son père. Alors, quand la lettre était arrivée, le petit Frédéric, devenu adulte, avait choisi de ne pas la lire. De laisser oubliées les choses oubliées.
Le train ralentit. C’était Eragny.
Á suivre demain...